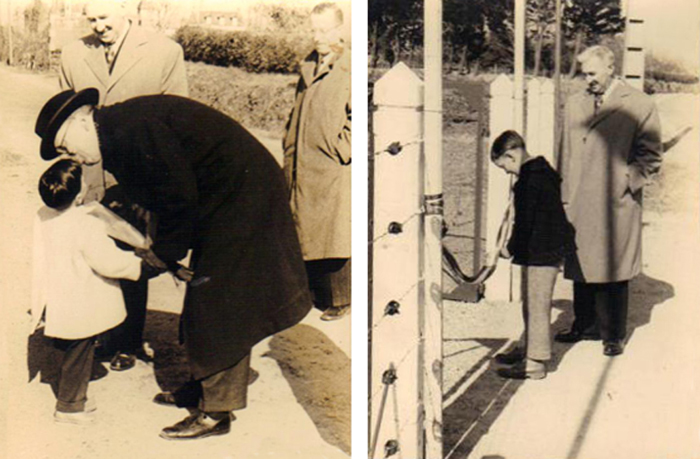LOUANNEC D’AUTREFOIS
DES ENFANTS SAUVÉS DES EAUX, EN 1841.
UN PASSANT COURAGEUX…
Extrait du Publicateur des Côtes-du-Nord du 25 septembre 1841 : « Le dimanche, douze septembre courant, à une heure de l’après-midi, le sieur Hervé Lissillour, cultivateur et propriétaire, demeurant au lieu de la Salle en Perros-Guirec, se rendait à vêpres à Louannec. Peu après avoir passé le nouveau pont qui sépare cette commune de celle de Perros-Guirec, il remarqua trois jeunes garçons, de 13 à 14 ans environ, qui se disposaient à se baigner. La marée montait avec rapidité dans cette partie de la baie de Perros. Peu de minutes s’étaient à peine écoulées depuis le passage du sieur Lissillour, lorsqu’il entendit pousser des cris d’alarme et de détresse ! Il vola immédiatement sur les lieux du sinistre, où il rencontra entièrement déshabillé, courant et criant comme un désespéré, le jeune Nicolas, l’un des baigneurs, qui lui signala ses deux infortunés compagnons que la force du courant avait entraînés et roulait déjà dans les flots, n’étant point encore assez forts nageurs pour refouler la marée qui les écartait du rivage. A la vue du péril imminent où se trouvaient ces deux jeunes imprudents, et n’écoutant alors que son courage déjà bien éprouvé en pareil cas et son humanité bien connue dans le pays, le sieur Hervé Lissillour s’est précipité tout habillé, sans quitter même ni chapeau, ni souliers, dans la mer où il saisit le jeune Le Bougant qu’il ramena et déposa sans connaissance sur le rivage ; il retourna vivement à l’eau et eût l’extrême bonheur de s’emparer du jeune Le Coz qui déjà coulait à fond : il le ramena également sans connaissance sur le rivage, où après leur avoir prodigué tous les soins en son pouvoir et les avoir rappelés à la vie, ils reprirent toute leur connaissance et purent bénir la main courageuse qui venait de les arracher, tous deux, à une mort malheureusement trop certaine.
Ces faits dignes des plus grands et des plus justes éloges, (dont les nommés Yves Perrin, fermier du lieu de Gousabas en Perros-Guirec, et François Lissillour, domestique de Jean Léon de Kergadou en Louannec, étaient témoins oculaires) n’ont pas besoin d’autres commentaires pour mériter et attirer la considération particulière et la bienveillance ordinaire de l’autorité supérieure sur la belle et dévouée conduite du sieur Hervé Lissillour en cette circonstance. La commune de Louannec lui gardera sans doute aussi une reconnaissance éternelle pour lui avoir conservé deux de ses jeunes adolescents. »
MAI 1858 – LE BATEAU D’UN LOUANNÉCAIN EN DIFFICULTÉ AUX ABORDS DE TOMÉ
Paru dans Le Lannionnais du 8 mai 1858 : Le bateau Marie, de Louannec, appartenant au sieur François Lissillour, marchand de sable à Louannec, étant sorti le 3 de ce mois pour aller faire du goémon, a touché sur un écueil près l’Ile Thomé. Une voie d’eau s’étant aussitôt déclarée, ce bateau allait sombrer et son équipage, composé du patron Le Parc et de quatre autres personnes, aurait infailliblement péri, sans l’équipage du sloop angalis Lady-of-the-Lack, de Guernesey, capitaine Piprell, qui s’est trouvé dans ces parages et qui s’est empressé de se porter au secours des malheureux naufragés qu’il a recueillis dans son canot et débarqués en lieu de sûreté à la Pointe du Château à Perros.
Encore le danger provenant d’un chargement de goémon ; heureusement qu’il existe une solidarité entre marins de différentes nations.
5 DÉCEMBRE 1859 – PÊCHE MIRACULEUSE À HAUTEUR DU LENN À LOUANNEC !
Paru dans Le Lannionnais du 10 décembre 1859 : Le lundi 5 décembre, un banc de poissons, dits mulets, poursuivi par les intrépides pêcheurs de Ploumanac’h, est venu se réfugier sur la côte de Louannec, près du sillon de galets dit Lequinn (ndlr : le Kinn). Cerné en cet endroit par les Ploumanacains dans leurs bateaux de pêche, le banc de poissons a été amené à terre au moyen de filets prêts à se rompre sous le poids. On a compté plus de 1.800 de ces poissons pris ainsi d’un seul coup de filet. Il y en avait de bien beaux dans le nombre. Le lendemain ils ont été enlevés à pleine charrette et à plein mannequin (ndlr : panier à claire voie) par les porteurs qui les ont achetés à 30 fr. le cent, ce qui a produit un assez beau bénéfice aux auteurs de cette capture.
ON SE PLAINT AUJOURD’HUI DES SANGLIERS. IL Y A 140 ANS, IL Y AVAIT DES LOUPS À LOUANNEC !
Un fait divers étonnant paru dans le Journal de Lannion du 16 décembre 1880 et repris dans le Bulletin 5 Pleumeur-Bodou en mémoires : « Le facteur de la commune de Louannec a rencontré dernièrement, en faisant sa tournée, un loup très grand et très gras qui paraissait sortir du bois et qui y est rentré en l’apercevant, et voici des faits qui viennent corroborer la version de cet homme. Vendredi dernier, M. Petit, propriétaire, Roz-Mab-Hamon (ndlr : aujourd’hui Rosmapamon), chassait avec ses deux chiens courants dans les environs de Barac’h. Ses chiens, poursuivant un lièvre, entrèrent sous-bois, et depuis ils n’ont pas reparu ; et puis, Le Rolland, fermier de la métairie de Kercoguen, entendant dans la nuit du samedi, un bruit étrange et les abois étranglés de son chien de garde, craignant une attaque de malfaiteurs, se leva à la hâte, s’arma du premier outil venu et sortit de chez lui. Il vit distinctement dans sa cour son chien aux prises avec un loup énorme. Son apparition et ses cris mirent en fuite le carnassier, qui dut abandonner sa proie ; mais le chien était si gravement mordu qu’il succomba le lendemain.
Une battue va, dit-on, être organisée dans la commune de Louannec, afin de détruire ou au moins de chasser ces terribles bêtes, qui y causent de graves dommages et tiennent le pays dans une panique continuelle »
10 AOUT 1880 – GRANDE FRAYEUR POUR DES GOÉMONIERS DE LOUANNEC FACE À UN CACHALOT DE PLUS DE 30 MÈTRES !
Paru dans Le Journal de Lannion du 12 août 1880 : Mercredi dernier, un cachalot d’une grandeur énorme, a été vu dans le chenal des 7 îles, par l’équipage de trois bateaux goémonniers du port de Louannec (ndlr : le port de Louannec était au bout du Lenn) Il mesurait selon leur estime, de trente à trente-cinq mètres de longueur et était d’une grosseur proportionnée. Comme il venait de bout à eux, par prudence, ils se sont hâtés de s’éloigner, les marins n’ignorant pas que, d’un seul coup de sa puissante queue, il eût pu briser leur embarcation.
NB : Un cachalot ne peut pas dépasser les 20 mètres. Il est permis d’exagérer !
DES CHEVAUX PRIMÉS À UN CONCOURS À L’OCCASION DE L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS EN 1900…
Deux éleveurs de Louannec, M. Bricquer et M. Prat ont obtenu des prix à un concours où figuraient près de 1.500 chevaux ! On peut lire ci-dessous le palmarès paru dans le Journal de Lannion du 15 septembre 1900.
Dans les années 50 et 60, je me souviens d’avoir entendu parler de M. Bricquer, éleveur, mais j’ignore où se trouvait sa ferme.
L’élevage du cheval de trait a perdu du terrain dès les années 50 quand est apparu le tracteur dans nos campagnes. Pour exemple, à Pleumeur-Bodou, il y avait 218 chevaux recensés en 1949. En 1959, il y en avait 189 et en 1969 plus que 50 ! Tous les ans, il y avait dans toutes les communes une journée de recensement des chevaux. Quand il s’est agi d’envoyer des chevaux aux centres de sélection de Guingamp et de Fougères au moment de la déclaration de guerre avec l’Allemagne, sont partis en priorité les chevaux les plus vieux ou les chevaux éborgnés. On rencontrait assez souvent des chevaux borgnes ou à moitié aveugles.
L’ÉGLISE ANCIENNE DÉMOLIE EN 1894…
Il aura fallu vingt années d’atermoiements, de réunions souvent houleuses pour arriver à la décision suivante : on démolit l’ancienne église et on construit une nouvelle. Le verdict est tombé en janvier 1894 alors que l’attention des paroissiens avait été attirée sur ce sujet le 20 mai 1873…
Que s’est-il passé le 20 mai 1873 ? Monseigneur Daniel, Evêque de Saint-Brieuc, est reçu à Louannec pour la commémoration du 570 ème anniversaire de la mort de Saint-Yves, nommé Recteur de Louannec en 12912. L’Evêque précise : « Les murs de l’église sont détériorés et menacent ruine. Des réparations s’imposent… »
Dès lors, le dossier passe entre les mains du Conseil municipal et celles du Conseil de fabrique (le groupe de personnes qui gèrent les biens de l’Eglise).
En 1873, Yves Tassel est maire « nommé » . Le 22 mai 1875, le maire élu Le Bricquir convoque son Conseil municipal et les 16 plus forts contribuables de la commune. On y remarque des noms qui ont traversé les années : Le Cozannet, Le Rolland, Lissillour, Le Merrer, Le Bellec, Cojean, Le Poncin, Tassel, Saliou, Nicolas, L’Hévéder…
A l’ordre du jour : Faut-il réparer ou agrandir l’église ?
Comme la commune s’est lancé dans la construction d’une école, on opte pour des réparations dans la mesure où le devis ne dépasse pas 30.000 francs. Le 14 janvier 1894, Joseph Allain, nouveau Recteur, passe à l’offensive : « Les murs de l’église menacent de tomber et l’insuffisance de place pour la population est notoire. » A l’issue de réunions houleuses, on décide la construction d’une nouvelle église comme ce fut le cas à Kermaria-Sulard, à Penvénan, à Rospez…
Mais, prudemment, personne ne parle de financement…
(D’après une enquête réalisée par Martine Le Gall)
Pour construire la nouvelle église, il a fallu transporter depuis les carrières de granit de l’Ile-Grande moellons, pierres d’angle, pierres taillées. François Hamel rappelle que son grand-père participait à ces charrois : « Sur un tombereau, on attelait un cheval de limon et deux ou trois chevaux de trait pour un parcours d’une quinzaine de kilomètres. Dans une charrette, on pouvait charger 2 tonnes (ndlr : un mètre cube de granit pèse 3 tonnes). Quand on pense que pour reconstruire l’église, il a fallu charroyer 470 m3 de pierres ». (D’après un article réalisé par Nicole Chapelain)
Les « plus forts contribuables de la commune » sont ceux qui ont offert des vitraux. Les noms des donateurs figurent en bas, à droite, de ces œuvres d’art.
Maintenant, pourquoi pas de flèche sur le clocher de Louannec ? D’après certains historiens locaux, ceci serait lié à la crise qu’a traversée la production du lin qui était source de richesse pour Louannec et pour tout le Trégor. Les caisses étaient vides et le Recteur de l’époque s’est plaint d’avoir eu à débourser pour payer en fin de travaux le dallage de l’église !
Le 19 mai 1996, Louannec a fêté le Centenaire de son église. Cent ans, comme l’atteste cette pierre posée à l’extérieur de l’église derrière le choeur côté est. Ce jour-là, Jean Nicolas, Maire, accueille l’Abbé Yves Bonniec, vicaire général représentant l’Evêque de Saint-Brieuc. La Pastorale de Pleumeur-Bodou a animé la cérémonie de ses chants. Jacques Mallédan, boucher-traiteur, successeur de François Lucas, « sert un buffet haut en couleurs et aux qualités gustatives appréciées par les 190 convives. »
FRANÇOIS LE GROSSEC, TRAVAILLEUR DE LA MER.
Goémonier, il était le patron de « L’Espérance ». 64 ans plus tard, son embarcation a servi de modèle pour la construction du Flambart « Ar Gentilez ».

A droite, le Ar Jentilez, toutes voiles dehors. Ce bateau a été construit d’après les plans
du flambart de François Le Grossec. (Photo Mairie de Perros-Guirec)
Le grand-père de Marie Esquenet qui habite Truzugal s’appelait François Le Grossec (1863-1930). C’était le père de « Visant » qui, l’été, promenait la famille Maupeou dans la baie de Perros à bord du « Marie-Antoinette ». Il habitait à Truzugal, au bas de la côte du Bourg. Normal qu’il fût attiré par la mer ! Il en fit sa profession. A mi-temps ou un peu plus ! Il devint « gommonenarc’h » ou goémonier. Une fois patron, il prenait la mer soit pour pêcher, soit pour aller chercher du goémon quand la campagne était ouverte, soit pour aller chercher du maërl qui était un excellent amendement pour les terres trop acides.
C’est à l’intention de François et d’une dizaine d’autres de ses collègues que fut construite en 1913 la cale-débarcadère que l’on peut voir, au bord de la voie douce, à hauteur du milieu du Lenn. Cette construction, longue de 28 mètres, a été pensée par Harel de la Noé, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Comme on évalue entre 5 et 8 le nombre de marins par bateau, il y avait près de 100 inscrits maritimes à fréquenter cet endroit bien abrité par le cordon littoral du Kinn.
Les hommes de la mer étaient aussi des paysans. Quand arrivait le temps de l’arrachage des pommes de terre, celui des foins, celui de la moisson, Ceux-ci mettaient sac à terre pour donner un coup de main à leurs amis cultivateurs. Sauf François qui avait choisi son camp. Il était un homme de la mer et il le resterait. Même pas question de s’occuper de son jardin-potager. A d’autres, les femmes de la maison, ces basses besognes. Il habitait tout près du moulin de « Soize » Rivoallan (Soize ar Vilin), le teillage de lin, de Truzugal. Il ne serait pas venu à l’idée de Soize de solliciter François pour les coups de bourre de la saison : arrachage du lin, sa mise en andins sur un pré pour le rouissage… Quand le marin traversait la route, c’était tout simplement pour aller, de l’autre côté, s’accouder au comptoir du café de Marie Kernanet qui s’appelait « La Buvette de la Côte ». François ne mélangeait pas les genres : c’était un homme de la mer. Un point c’est tout…
Son bateau, un solide goémonier-sablier-caseyeur a été construit en 1906. François s’était adressé au chantier Bernard de La Roche-Jaune. La carrière de ce bateau ventru (« koved » en breton) s’est terminée en 1928. Après six années dans un cimetière à bateaux, l’épave a été dépecée en 1934…
Il semblerait que chaque bateau avait sa propre structure. On dit qu’un marin avisé reconnaissait de loin en mer de quel port venait une embarcation. Il le savait du premier coup d’oeil à son allure générale et à sa voilure. Le sardinier de Locquémeau était différent du sablier de Lannion. Le sablier de Lannion ne ressemblait pas au bateau de pêche de Trébeurden ou de l’Ile Grande. Celui-ci n’avait pas la silhouette du goémonier de Perros-Guirec. Ce dernier différait des embarcations de Port-Blanc ou de Tréguier. Et ainsi de suite, si nous poussions nos investigations vers l’est des Côtes-du-Nord.
Tous les ans se déroulaient à Perros-Guirec de grandes Régates. Les articles de l’époque, publiés dans Le Lannionnais, évoquent des festivités très prisées et très suivies. Des trains supplémentaires déversaient une foule de spectateurs, venus de Paris, dans la toute nouvelle station balnéaire. La description du public ressemble à ce que peut être un champ de course le jour du Grand Prix d’Amérique : hommes en canotier et femmes portant grandes tenues se mêlaient à une population locale vêtue sans aucun faste, les femmes portant tout de même la coiffe du Trégor. L’événement de la journée était la course des bateaux ou Régates. En 1908, François Le Grossec avait concouru en catégorie 1 et avait tiré son épingle du jeu. Il s’était classé à une honorable troisième place derrière le « Marie-Françoise » dont le patron était Croc et le Saint-Yves barré par Kéromen. Cette journée fut endeuillée par un drame. Léon Guillaume à bord des « Deux frères » , après avoir talonné une roche, coula. Le marin et son mousse, Sylvestre Crechriou, 14 ans, disparurent corps et biens avant l’arrivée des secours… Il semble que le journaliste de service, même si ce jour-là soufflait une forte brise de nord-ouest, force le trait quand il écrit : « Ces marins aussi habiles qu’intrépides ont effectué leur parcours à une vitesse qui ne s’atteint que rarement. » Ces bateaux, on les appelait encore « des tape-cul » !
Pendant que les marins rivalisaient, toutes voiles dehors, dans la baie, c’était la fête au port et sur le quai. Dans l’eau : courses à la nage, plongeurs, courses aux canards, jeu de godille réservé aux femmes. Sur terre : casse-pots, mât de cocagne, etc…Et on enchaînait le soir par des soirées dansantes : accordéon pour les amateurs de musette ; cornemuse et bombarde pour les amateurs de danses bretonnes.
Quand l’association des « Vieux Gréements » de Ploumanac’h a souhaité construire le « Ar Gentiles », le plan retenu a été celui de « L’Espérance », le bateau de notre marin louannécain. Le flambart perrosien, baptisé en 1992, a aussitôt rejoint le port de Brest où avait lieu un grand rendez-vous international.
(Remerciements à Vincent Claveau, arrière-petit-fils de François Le Grossec, pour les documents qu’il nous a fournis)
PAS DE RETRAITE POUR « SKOLER COZ » : 50 ANS INSTITUTEUR ET 72 ANS SECRÉTAIRE DE MAIRIE DE LOUANNEC !
Émile Le Poncin parle du vieil instituteur qu’il a eu de 1909 à 1914 ! : Pour faciliter la lecture, je n’ai repris de cet article que les propos tenus par Emile Le Poncin au sujet de « skoler coz »… (d’après un article paru dans Ouest-France)
M. François Nicolas, c’est bien sûr un Louannécain de l’autre siècle (ndlr : le 19 ème !) mais quel exemple ! 72 ans de service, c’est un record… Je l’ai bien connu pour l’avoir salué chaque jour pendant les 5 années que j’ai passées à l’école primaire de Louannec et qui furent les dernières années de sa longue vie… M. Nicolas était né à Plouzélambre de parents agriculteurs. A 14 ans, il resta à la ferme dans le but de prendre le relais. Mais la première fois que son père lui confia un attelage, le jeune Phaéton renversa sa charrette. Sur le coup, le père jugea que son fils avait plus de dispositions pour être instituteur plutôt qu’agriculteur !
En 1842, à peine âgé de 18 ans, il ouvrit une école à Louannec avec l’appui d’un ami de la famille, Me Yves Tassel, notaire et maire. On dit souvent que la première école fut dirigée par Melle Blanchard. Erreur ! M. Nicolas dirigeait une école avant la naissance de Marie Blanchard !
L’école se trouvait au bas du bourg, au Carpont. Les élèves étaient nombreux de Louannec et des communes voisines. Les écoliers n’hésitaient pas à faire 5 ou 6 kilomètres, par tous les temps, chaussés de sabots ferrés, morceau de pain en poche. Il fallait verser une faible rétribution à la fin de chaque trimestre. C’était encore trop pour beaucoup de familles qui trouvaient là un prétexte pour ne pas scolariser leurs enfants…
« Monsieur » Nicolas était un éducateur inégalable. L’instruction morale et les devoirs de civilité avaient une large place. Il insistait aussi sur l’histoire, la géographie et surtout la botanique. Certains élèves de 12 ans avaient un meilleur français que les bacheliers d’aujourd’hui !
Dans un but philanthropique plutôt que lucratif, M. Nicolas créa dans sa maison du bourg un fonds de commerce tenu par sa femme puis par sa fille : épicerie, mercerie, draperie, chapellerie, droguerie. On trouvait tout, et de première qualité. Les clients, fort nombreux, payaient quand ils pouvaient. La discrétion était assurée.
En plus de son école, du secrétariat de la mairie et de son commerce , M. Nicolas était écrivain public. Il était encore plus heureux quand il aidait les foyers à court d’argent. Sa devise : Il faut faire le bien parce que c’est le bien ! C’était un catholique convaincu, il y avait prière à l’école jusqu’à l’arrivée de Jules Ferry. Il ne prit jamais part aux batailles électorales , mais il se réjouissait fort des victoires de ses mais Yves Tassel, maire député et Armel Le Troadec, député..
Usé par l’âge et le travail, François Nicolas mourut en 1914. Il avait 90 ans. La foule assista à ses obsèques célébrées par son ancien élève, l’Abbé Saliou qui fut curé de Paimpol. Discours d’Alfred Le Toiser, directeur d’école à Perros-Guirec, de Jean Rolland, Maire de Louannec.
On pourrait donner le nom de François Nicolas à une rue de Louannec
Remarques :
1 – Ne pas confondre François Nicolas dont parle cet article avec François Nicolas, de Kernasclet. Son homonyme, un siècle plus tard, a été un maire de transition entre deux longs mandats : celui de Pierre Bourdellès et celui de Jean Nicolas.
2 – Henriette Psichari écrit que la première école de Louannec a été créée à l’initiative de son grand-père Ernest Renan. Faux quant à « la première école » ; vrai s’agissant « de l’école des filles ».
CHARLES LINDBERGH À LOUANNEC…

En 1927, l’aviateur américain Charles Lindbergh réussit le premier la traversée sans escale de l’Atlantique nord à bord du Spirit of Saint Louis. 300.000 personnes l’accueillent dans la liesse au Bourget. Véritable star de l’époque, le héros fait la une de tous les journaux et magazines. Pierre Bourdellès me dit ceci un jour : « Un matin, qui je vois arriver dans la cour de la ferme ? Je n’en croyais pas mes yeux. C’était Charles Lindbergh. Il me dit : Monsieur le Maire, la vallée du ruisseau de Nantouar est la plus belle que je n’aie jamais survolée de ma vie. Y aurait-il là une habitation qui pourrait me convenir ? »
Comme l’affaire ne peut être conclue à Nantouar, l’aviateur américain jette son dévolu sur Plougrescant où il fait l’acquisition de l’Ile Illiec.
À L’ÉCOLE DE LOUANNEC ENTRE 1920 ET 1930…
A l’époque, les instituteurs étaient M. et Mme Riou. Quatre Louannécaines (décédées depuis) qui ont été leurs élèves se sont confiées, il y a plusieurs années à Nicole Chapelain. Leurs propos ont été publiés en breton et en français dans le Bulletin Municipal. Nous en extrayons les passages les plus savoureux.
Perrine Charles qui deviendra plus tard Perrine Crocq, épouse d’Yves secrétaire de mairie. Elle tiendra un café-épicerie au Croajou : « Mme Riou s’est occupée des petits pendant plus de 20 ans. M. Riou enseignait aux garçons. Je me souviens surtout de Mme Blanchard. J’étais « très bien vue » parce que, de temps en temps, je lui apportais du tabac à priser ! Cette institutrice habitait à Perros, en haut de la côte de Landerval et venait, tous les jours, à pied jusqu’à Louannec. »
Perrine Roux, future Mme Rivoalland : « On allait à pied à l’école depuis Coat Gourc’hant avec notre gamelle de soupe. Attention à ne pas la renverser ! Un jour, nous sommes restées jouer sur le pont de Mézernec à laisser filer nos sabots sur la rivière. Et bien entendu, j’ai perdu un sabot ! Que faire ? Aller jusqu’au bourg à cloche-pied ? Revenir à la maison pour se faire battre ? Autant rester traîner dans le bois de Barac’h à ramasser des châtaignes… »
Joséphine Corre, future Mme Kerbiriou : « J’aimais beaucoup l’école. J’ai passé mon certificat en 1927. Nous étions 7 à le passer et 6 avaient été reçues… Pierre Cogan nous avait conduites à Perros en voiture à cheval. En rentrant à la maison, diplôme en poche, on m’a dit : Il est plus que temps d’aller garder les vaches ! Notre institutrice Mme Lasbleiz nous conseillait de passer du pétrole dans nos cheveux pour tuer les poux ! Elle me disait : Continue à lire quand tu seras à la maison. Qu’est-ce que je pouvais lire ? De toute façon, on me disait : Tu ferais mieux de tricoter… »
Ernestine Rouzès, future Mme Le Calvez : «Je n’étais pas une bonne élève. Je préférais garder les vaches à Kerjean plutôt que d’aller à l’école ! Là au moins, on me donnait du pain avec du lard et un pot de flan d’œuf ! Mme Lasbleiz me mettait souvent en pénitence, à genoux auprès de son bureau. Je trouvais le temps long ! Je n‘avais qu’une chose à faire : regarder sous les jupes de la Madame quand elle écrivait au tableau. Elle avait un grand caleçon blanc avec de la dentelle rouge ! Un jour, elle m’a mis sur la main un des ces coups de bâton. Quelques années plus tard, il m’est venu un kyste à cet endroit-là. Le Dr Etesse de Tréguier me l’a enlevé. Voilà pourquoi je me souviens encore de Mme Lasbleiz… Que Dieu lui pardonne. »
LA CANTINE SCOLAIRE
Texte écrit par Yves Crocq, ancien secrétaire de mairie… Quelques anciens de Louannec se rappellent peut-être d’un article qui parut dans un des deux hebdos lannionnais vers 1928. Article qui était signé H.L.P.. Son titre était : A Louannec, la cantine scolaire n’est plus une chimère »
Effectivement, Mme Marie Le Poncin, veuve Hernot, tenancière de la Pension de Famille du Carlouar (propriété actuelle de Mme Augustine Carluer) qui venait d’ajouter à sa propriété une construction annexe (propriété actuelle de M. et Mme Michel Darrort) avait décidé d’ouvrir une cantine scolaire où les élèves de l’école publique pourraient prendre leur repas de midi.
Ces repas étaient servis dans une pièce de la construction annexe prévu pour un garage et dont la porte d’entrée donnait sur la route.
Malheureusement, faute de place, le nombre des élèves était limité et seuls pouvaient y prendre leur repas ceux dont les familles étaient les plus éloignées de l’école et aussi les plus nécessiteux.
Parmi la population actuelle, il y a sans doute encore quelques anciens élèves qui ont fréquenté cette cantine.
Dommage que l’existence de cette cantine ne fut pas de longue durée car la tenancière, par suite d’un changement dans sa situation de famille consécutif à son remariage, dut passer une partie de son temps dans la région parisienne où résidait son mari et elle n’ouvrait plus son établissement que pendant les mois d’été.
Pendant un certain nombre d’années, il ne fut plus question de cantine scolaire.
A partir de 1941, pendant l’Occupation allemande, Melle Le Calvez, Directrice de l’Ecole des filles, malgré les restrictions des denrées alimentaires, avait réussi à se procurer quelques produits lui permettant de préparer dans sa propre cantine une soupe chaude qu’elle servait tous les midis, pendant les mois d’hiver, aux élèves les plus éloignés et aux plus démunis. Pour ce service, elle disposait de deux tables installées dans une des classes. Le service et la préparation des repas étaient assurés par une personne employée par la Directrice de l’école.
A partir du 1er octobre 1945, sous l’égide de la municipalité, ce même service fut assuré par Mme Briant (Marie Kérimel) à son domicile, au bourg. Le nombre d’élèves pouvant participer aux repas était toujours limité faute de place suffisante. Mais les repas étaient plus copieux du fait que la commune avait la possibilité d’obtenir quelques denrées supplémentaires : confitures, compote de pommes, etc…

J’y suis allé de 1950 à 1955. Seuls y allaient les élèves qui habitaient loin du bourg.
C’était un accord entre les parents et la cantinière, Marie Kérimel. Les parents n’étant
pas fortunés, il ne nous était servi qu’un plat unique : soit une assiettée de semoule,
ou de riz, ou de purée. C’était tout : ni entrée, ni dessert… Comme à la maison en fait…
A partir du 1er octobre 1956, dès la construction du Foyer rural, Mme Briand continua son service dans les locaux du Foyer où elle disposait d’une cuisinière et de tout le matériel nécessaire : tables, ustensiles de cuisine permettant de recevoir tous les enfants des écoles qui désiraient y prendre leur repas.
Désormais, la cantine scolaire disparaîtra et sera remplacée par le Restaurant d’enfants…
DOUBLE MARIAGE À CABATOUS EN 1936…
Cabatous ? Maudez Glandour lui-même n’a pas pu trouver l’origine de ce nom qui apparaît quelquefois, dans certains documents, sous la forme de Cabatouche. Ce domaine qui se trouve au bord de la route Mabiliès/Trélévern, sur la droite, est tombé à partir de 1688 sous la domination de la famille Pelletier de Rosanbo (de Lanvellec).
Les bâtiments appartiennent actuellement à Gérard Goasampis et à son épouse, cultivateurs à la retraite. Ce couple a aménagé avec beaucoup de goût les dépendances pour en faire des gîtes ruraux de qualité.
Les terres sont cultivées en GAEC par leur fils Thierry qui est associé à Daniel Rolland (ex-Goasquéo). Ils privilégient l’élevage de vaches laitières et la production de lait.
C’est à cet endroit qu’a eu lieu en 1936 ce double mariage. 1936, est-il besoin de le rappeler, est l’année où le socialiste Léon Blum a accordé à tous les travailleurs deux semaines de congés payés. Cette année-là a été le départ du tourisme de masse, privilège qui, jusque là, n’était que l’apanage des classes aisées.
Le marié, à gauche, René Simon est régisseur du teillage de lin de Milin Dirigin, pour le compte de Pierre Saliou. Ce moulin a été transformé depuis en une grande bâtisse luxueuse. Ce couple aura six enfants en sept ans, dont moi le benjamin. L’un des enfants, une fillette de 3 ans, périra noyée dans le bief du moulin, ayant échappé à la surveillance de ma mère.

Le deuxième couple est celui de François-Marie Goasampis. C’est lui, cultivateur à Truzugal, qui vendra à la commune de Louannec, en 1974, les deux champs qui ont servi de support au Camping Ernest Renan, le reste étant établi sur le domaine maritime.
Lorsqu’il y avait un mariage, on vidait la grange de tout son contenu. On la nettoyait. On disposait des draps blancs pour cacher la saleté des murs. On disposait des tables sur des tréteaux. Je vois mal comment les 100 invités à ce mariage ont pu trouver place dans la grange en question. Les enfants ont été placés quelque part ailleurs. Mais même en agissant ainsi… Le soir, après le repas, on enlevait les tables. On dressait une estrade pour les musiciens, généralement un plateau de charrette. Et place pour le quadrille et la polka piquée…
Un mariage de ce type nécessitait une bonne semaine de mobilisation d’une vingtaine de jeunes serveuses et serveurs : les filles à la « déco » et les gars au cul du fût pour le service « boissons ». Ces longues périodes de préparation ont été favorables à des rapprochements et de nombreux couples se sont formés…
Cette photo présente un autre intérêt si on met le focus sur au moins deux personnages qui figurent parmi les invités. Au troisième rang, derrière les mariés, se trouve Pierre Bourdellès. Il était cultivateur à Mabiliès. Il fut contraint de venir à la ferme suite au décès de son père alors qu’il s’apprêtait à entamer des études de médecine. Celui-ci a été élu maire de Louannec l’année précédente en 1935. Il le restera jusqu’en 1983, établissant le record de 48 ans à la tête de la commune. Il sera conseiller général et député à plusieurs reprises. C’est lui qui a modernisé la commune, qui l’a façonnée jusqu’à la construction de trois nouveaux quartiers : la Cité Saint-Yves, celle de Calouer et celle de Mabiliès. Il a été un des artisans de la venue du CNET à Lannion…
Sur la droite, au deuxième rang, (juste devant l’homme au chapeau qui donne l’impression d’avoir un peu d’avance sur le reste du groupe), c’est Edouard Ollivro, jeune homme. Orphelin, il a été élevé au teillage de lin de Truzugal par Soêze ar Vilin. Le jeune homme manifeste un tel intérêt pour la lecture que Soëze pense : Celui-là, on n’en fera rien de bon ! C’est lui qui écrira « Picou, fils de son père » au cours d’une très longue convalescence due à la tuberculose, maladie répandue et redoutable à l’époque. Edouard deviendra professeur d’histoire et géo, maire de Guingamp et député sous étiquette « centriste ». Il aimait revenir à Louannec où il connaissait tout le monde. C’est lui qui m’a guidé dans la façon d’aborder la première monographie que j’ai faite sur la commune de Louannec en 1963-1964. C’est à lui que nous avons emprunté le nom de notre site. Merci Edouard…
DES ANCIENNES DE L’EHPAD RACONTENT…
Ces anciennes de Louannec se sont fait un plaisir de nous raconter quelques souvenirs de jeunesse…
Fernande Prat, 90 ans. C’était à Coat-Rumanton, à Brélévenez. Mon père allait avec ses deux chevaux porter une charretée de fumier dans un champ. Tout-à-coup, en croisant un autre attelage, ses chevaux se sont emballés. Mon père a voulu tirer le frein sur une des roues, mais il a glissé et il a été écrasé. Il avait 47 ans. Nous étions huit enfants à la charge de ma mère. Moi, j’avais 13 ans… Pendant l’Occupation, quand des Allemands passaient devant la ferme, on avait peur. On allait se cacher dans la grange. Pierre Bourdellès était copain avec mon oncle Eugène Le Martret qui était maître d’hôtel à Paris. Dans les bals, chez Jaguin à Rospez, j’avais 9 courtisans ! Ils étaient autour de moi. Je ne pouvais pas aller danser. A la fin, j’ai été obligée de choisir…
Ernestine Briand, 88 ans. Pour moi, c’’était que je faisais de la couture après l’école. Ensuite, aller travailler dans les maisons. J’allais chez toi, Jean-Paul, réparer vos habits. On était quatorze enfants à la maison, à Keryann Bihan. Il y avait le train à la gare de Mabiliès, mais quand on allait au marché à Lannion, c’était toujours en char-à-bancs. L’autre jour, on a vu à la télévision, un des mes petits-fils qui a été élu meilleur apprenti de France, en cuisine. J’étais fière de lui…

de collecte sur des sujets de la vie d’antan qui nous passionnent. (Photo Michel Prat)
Monique Garlan, 87 ans. Je suis née au Havre. Mon père était marin. Je ne suis arrivée à Louannec, au Croajou, qu’à l’âge de 6 ans. J’ai été étonnée de ne voir que des champs avec des vaches. Mais ça me plaisait beaucoup. J’ai élevé les quatre enfants de ma sœur sans avoir aucune aide. Ils ont été à l’école à Louannec. Aujourd’hui, aucun d’entre eux ne pense à moi… Il y avait des bals dans le garage chez Gouriou, mais ma mère ne voulait pas me laisser aller. Il a fallu attendre que j’aie 19 ou 20 ans. Et à chaque fois, il fallait rentrer à la maison avant l’Angélus (19 heures !)
Eugénie Boulanger, 93 ans. Moi, c’était surtout les travaux des champs : semer et ramasser les patates. J’allais travailler à Kerhoguen, à Goasmorgan et à Barach-Philippe… Dans les bals, on dansait la polka piquée. C’était bien…
Guy Lelias, 86 ans, bien que n’étant pas originaire de Louannec, s’est joint à notre groupe. J’habitais à Brest, ville qui a été bombardée. Deux cousins et une tante ont été tués à ce moment-là. Guy, très ému, dit être venu se réfugier avec sa famille chez des parents à Perros-Guirec. On habitait à la Rade.
DOMINGUE PHILIPPE, UNE JEUNESSE À LA DURE…
Le jour où j’ai frappé à sa porte à Trélévern, le 13 février 2018, c’était l’anniversaire de Domingue Philippe. Il avait 86 ans tout ronds, ce jour-là. Domingue est fier de m’accueillir dans une maison qu’il a construite de ses propres mains. On aurait pu dire de A à Z, s’il avait fait lui-même l’installation électrique ! L’objet de ma visite était de recueillir quelques informations sur la vie de son quartier du temps de son enfance. Et aussi sur la manière dont une famille aussi nombreuse que la sienne s’organisait à une époque où la vie n’était pas un long fleuve tranquille… Voici comment vivait à Kervélo une famille de 17 enfants …
Kervélo est un tout petit hameau. Sur des cartes anciennes, on note aussi le mot Kermélo. Nous avons là avec Mélo un nom d’homme, celui de Maël qui signifie « noble ». Un adjectif pas très approprié à une famille qui a connu la misère, la misère noire. On passerait dans ce hameau de deux ou trois maisons presque sans s’en rendre compte. On amorce la descente vers Cabatous laissant sur la droite la ferme-manoir du même nom… A cent mètres, en face de la maisonnette, une fontaine où la famille s’alimentait en eau…
Domingue est né de l’union de Pierre Philippe, originaire de Ploumilliau et de Yvonne Cudennec qui a vécu sa jeunesse à Ploubezre. Pierre qui est maçon a trouvé un emploi à l’Entreprise Zampèze à Trévou-Tréguignec. Il s’installe donc à Kervelo en Louannec avec sa femme Yvonne qui, n’ayant pas fréquenté l’école, ne sait ni lire ni écrire…
Domingue sera l’un des 17 enfants Philippe. Les difficiles conditions de vie (hygiène approximative, froid, malnutrition) font que six d’entre eux meurent en bas âge… Aujourd’hui, le taux de mortalité infantile en France est inférieur à 4 pour 1000. Dans la famille Philippe, il a été de 350 pour 1000. Inutile de faire un dessin !
« C’est simple, commente Domingue, si sabots pas à manger ; si manger pas de sabots ! Ces sabots qu’il fallait préserver le plus longtemps possible. Nous étions une quinzaine de gamins du quartier à rentrer ensemble de l’école : 4 ou 5 de chez nous, autant de Lamézec et autant de Le Saux. On tenait les sabots dans les mains pour ne pas les casser. On préférait marcher pieds nus plutôt que de recevoir une tournée si on rentrait avec des sabots fendus…Souvent, on volait des pommes de terre dans les champs… Il fallait bien se débrouiller… Ce qui ne plaisait pas à ma mère qui était une brave femme. Elle était croyante. Mon père, lui c’était le diable. Quand il avait bu, il était impossible. Le mélange alcool – jalousie le rendait furieux. Il nous traitait de « bâtards ». Je ne sais pourquoi, mais moi il ne m’aimait pas. Quand il faisait ce type de crises, ma mère et moi, on partait. Qu’il fasse chaud ou qu’il fasse froid, on allait dormir dans la paille dans la grange, chez François Person. Comme des bêtes ! Ceci dit, mon père était travailleur et c’était un excellent maçon. Peu de temps avant de mourir, il m’a dit : « Domingue, j’ai été méchant avec toi ! » Quand il était à jeun, il n’y avait pas plus gentil que lui. C’était alors un brave homme… »
Toute cette grande famille vivait dans une maison toute petite. Deux espaces avaient été aménagés dans le grenier. Les garçons dormaient à quatre dans le même lit tête-bêche. « Comme cela, au moins, on se tenait chaud », dans une couette en balle de blé ou d’avoine que l’on récupérait dans une ferme le jour du battage…
Domingue se voit affaibli par ces dures conditions de vie. Il devra passer deux ans au Sanatorium de Trestel où on soignait la tuberculose. Deux années de traitement sans la moindre intervention d’un enseignant, sans le moindre apprentissage de la lecture, de l’écriture ni du calacul. De retour au bercail, le petit Domingue reprend le chemin de l’école. On l’isole au fond de la classe. Pareil à la cantine de peur qu’il ne contamine ses camarades. « L’instituteur M. Cornec était gentil, poursuit Domingue. Il y avait des fils de paysans qui arrivaient avec du pain et du lard. Il leur demandait de partager avec nous. Quand ils ne voulaient pas le faire, mon frère Noël leur volait dans les plumes. M. Cornec disait : « Vous n’avez pas honte de donner envie à des garçons qui n’ont pas à manger à la maison ! »
De la guerre 39-45, Domingue garde quelques souvenirs : « Nous avions une peur bleue des Allemands. Le soir, on entendait le bruit des bottes d’un groupe de soldats qui passaient devant chez nous en chantant : Halli Hallo. Ils venaient à pied de Servel et dormaient à la ferme de Cabatous. Quand ils voyaient de la lumière dans la maison, ce qui était interdit, ils donnaient des coups de crosse dans les volets… Je me souviens aussi de l’avion allemand qui avait été abattu derrière la ferme de Kerruado. Les jours suivants, on allait ramasser le mica pour en faire des bagues… »
Son père, Pierre, se comportant toujours aussi durement envers lui, sa mère conduit Domingue à Trézény chez un oncle. Pour passer le temps, en gardant les vaches, le jeune Louannécain s’occupe en fabriquant des chaussons avec de vieux pardessus et des chaussettes en utilisant de vieilles étoffes. Une vocation était en train de naître…
Domingue s’oriente tout naturellement vers le métier de tailleur qu’il apprendra et exercera chez Yves Person à Petit-Camp, chez François-Marie Pierrès à Trévou-Tréguignec et chez Yves Le Lay à Plouaret.
Le service militaire va donner une autre direction à sa carrière. A 20 ans, c’est le service militaire à Brest. « Quand j’ai voulu m’engager dans la « Royale », le service terminé, j’ai été rejeté parce que j’avais 2 en français. J’avais bien 10 sur 10 en breton mais ça ne comptait pas ! plaisante-t-il. Je me suis alors tourné vers la marine marchande où on ne m’a pas demandé si j’avais mon certificat d’études ! Ils ont vu que j’avais de bons bras et ça leur suffisait… Je suis devenu matelot… Pendant plusieurs années, on a convoyé les vivants vers l’Indochine et on a ramené les morts ! On transportait aussi des armes et du matériel nécessaire au bon fonctionnement des troupes. Il fallait 21 jours pour y aller. On restait trois ou quatre jours pour décharger le fret et 21 jours pour revenir à Marseille… Au cours de ces années, j’en ai connu des tempêtes mémorables : au Cap de Bonne Espérance qui passe pour être le trou le plus dangereux au Monde ou au large d’Ouessant où nous sommes restés 48 heures en difficulté. Mais un marin n’a jamais peur… »
Domingue aura navigué 33 ans. A force de travail et de sérieux, il devient Maître d’équipage sur le Pont avec la responsabilité de huit matelots. Il est à sa 31 ème année de retraite, regrettant la disparition il y a quelques années de son épouse dans d’atroces souffrances. « Ma femme était très douce et gentille. On se fréquentait depuis l’âge de 14 ans. Elle était très croyante. Moi, je ne le suis pas. Ca ne nous empêchait pas de bien nous entendre. »
De cette famille nombreuse, il ne reste plus aujourd’hui que 3 survivants.
RESCAPÉE DU NAUFRAGE DE LA « PETITE ANNIE » PRÈS DE LA POINTE DU CHÂTEAU, LE 8 AOÛT 1948, MARIE-FRANCE MORVAN TÉMOIGNE…
Marie-France Morvan avait 14 ans en 1948 quand le sloop « La Petite Annie » a chaviré, entre la Pointe du Château et Roc’h Hu, causant la noyade de 9 passagers. Nous l’avons rencontrée à Tréguier, elle qui a survécu à ce drame. Bon pied bon œil, elle a aujourd’hui 85 ans et elle est toujours très active au sein de l’Université du Temps Libre de la cité de Saint-Yves et de Renan. Elle raconte :

« Il faisait beau ce 8 août 1948 et on se faisait une fête d’aller faire un tour du côté des Sept Iles. Mathurin Le Grossec habitait au Linkin une maison qui appartenait à mes parents. Il était retraité de la marine nationale. Il avait un bateau un peu ancien qu’il avait baptisé « La Petite Annie » en l’honneur de la petite fille que son épouse et lui-même avaient adoptée. Mathurin avait invité mon père, une jeune fille du Midi liée à une tante, moi et deux collégiennes du Pays de Galles qui nous accompagnaient. Mathurin avait un matelot, Allainguillaume qui avait fait venir sa fille et son gendre. Nous étions 13 personnes à bord en tout. Nous avons navigué à la voile…
Un jeune homme qui deviendra plus tard mon mari était parti pêcher la crevette aux Iles avec un autre bateau. On rentrait. Il y avait beaucoup de bateaux en mer. Au niveau de La Roche Bernard, comme il y avait du courant, Mathurin a voulu mettre le moteur en marche. Allainguillaume s’est alors mis à la barre. Une forte risée a mis Allainguillaume à l’eau. Et puis, tout le monde… Comme j’étais une bonne nageuse, j’ai cru que je pourrais atteindre la côte qui était à une centaine de mètres. J’avais appris à nager dans le lac du Linkin avec un moniteur qui s’appelait André Huon. Pour améliorer notre nage, il nous avait habitué à de longues distances comme traverser tout le port… J’étais à l’eau en short et en tennis. J’étais loin de tous les autres. Et le courant me poussait vers Trélévern. J’ai dû nager pendant trois quarts d’heure dans une mer agitée. Le fils Paternotte qui était par là, m’a ramenée. J’étais groggy. Je me suis retrouvée dans un lit, une employée de la maison s’occupait de moi. On m’a gardée là quelques jours…

Elle s’appelait alors de son nom de jeune fille Marie-France Guillou.
Ce n’est qu’alors que j’ai appris que mon père faisait partie des victimes et avait été enterré à Tréguier où ma mère était adjointe au maire Charles Colvez. Une de nos amies galloises est morte aussi dans ce naufrage. J’ai eu l’occasion d’aller depuis chez les parents qui étaient mineurs. J’ai été très bien reçue. En tout, il y a eu 9 victimes sur les 13 personnes qui étaient à bord. Parmi elles aussi, un touriste parisien et son jeune fils.

Mme Jouan, historienne de l’église de la Clarté, avait alors 18 ans. Elle a tenté la respiration artificielle à plusieurs noyés sur le quai. En vain..
Mathurin faisait partie des 5 rescapés. Il n’a survécu que 15 jours à ce drame, emporté par une pleurésie et aussi sans doute par le chagrin.
Un jour, j’ai eu un coup de fil de la fille d’Allainguillaume. Elle voulait savoir pourquoi elle n’avait pas eu de mère car dans sa famille on n’a jamais parlé de ce drame. Elle n’a donc eu la réponse à cette question qui la taraudait qu’à 50 ou 60 ans !
Je pense que « La Petite Annie » a été renfloué et racheté par un certain Lorvellec… Ce drame a accéléré la mise en place de l’Aimée-Hilda, le bateau de sauvetage de Ploumanac’h.
Comme je ne voulais plus mettre un pied en mer, un jour ma mère m’a demandé pour me ré-mariner d’accompagner quelqu’un qui allait relever un casier à Roc’hu. La sortie s’est terminée aux Sept Iles. Par la suite, ça allait mieux. J’ai fait des stages de voile aux Glénans et j’ai eu un bateau…
Cette journée me revient de temps en temps en tête ; mais il faut continuer, il faut avancer, il faut faire avec…
C’est curieux. Il n’y a pas longtemps, une autre personne m’a demandé de parler de cette balade qui a tourné au drame. C’était la petite-fille du peintre Maurice Denis. »
MORT ET DEUIL À LOUANNEC DANS LES ANNÉES 50…
J’avais 10 ans en 1954. J’étais en CM2, classe de M. Guinard, un instituteur que j’appréciais beaucoup. Le samedi 11 décembre, on m’annonça la mort de ma mère, hospitalisée quelques jours plus tôt. Elle s’appelait Thérèse. Elle avait 42 ans et avait eu 6 enfants en 7 ans. Elle tenait un débit de boissons/épicerie à Mabiliès. Mon père, René, travaillait au teillage de lin de Pierre Saliou à Kerscoac’h, là où on voit une maison de style normande. En 1955, quand l’entreprise Saliou s’est délocalisée vers Mondeville, dans la banlieue de Caen, il est devenu ouvrier agricole…
Je ne reviendrai pas sur le déroulé de ces trois jours que je pourrais relater, 65 ans plus tard, presque heure par heure.
Le lundi 13 décembre, il faisait froid, très froid. Un convoi funéraire quittait Mabiliès pour se rendre à l’église. Une voiture-reposoir portant le cercueil, tirée par un cheval, ouvrait la marche. Vingt à trente personnes, ma famille, suivaient à pied cette charrette de l’Ankou, précédées par le Recteur Jean-Baptiste Guégou qui chantait des prières. A l’église, une foule d’amis. A l’époque, comme tout le monde se connaissait, à chaque enterrement, chaque famille déléguait au moins une personne à la cérémonie mortuaire… Marie-Renée Le Bivic m’a apporté des précisions sur ce cortège funèbre. On a déjà parlé de Marie-Renée, du jour où son père Jean Le Cuziat était rentré de captivité, d’Allemagne. Elle avait 7 ans et elle ne le connaissait pas ! Ordre lui avait été donné de lui faire un bon accueil. Lorsqu’elle vit arriver un homme dépenaillé, la barbe noire, la veste déchirée, une sorte de Père Fouettard, la petite fille, farouche et apeurée, alla se cacher derrière le tas de paille. Sa mère de la rejoindre et de lui administrer une baffe qui résonne encore dans sa tête 73 ans plus tard !

les défunt(e)s de Louannec à leur dernière demeure.
Son père reprit donc le travail à sa ferme de Kerloas et aussi une activité annexe, celle de « Pompes funèbres ». Marie-Renée raconte : « Pour l’enterrement de ta mère, la jument noire qui tirait le corbillard, s’appelait Fanny. Pour chaque cérémonie, on nettoyait à grande eau le corbillard sur lequel nichaient les poules. On faisait la jument belle. On la brossait. On peignait sa crinière. On nettoyait ses sabots qu’on enduisait d’une espèce de cambouis. Les sabots du cheval, seulement pour les enterrements « première classe »… Tout ça, ca demandait beaucoup de temps et en plus le travail à la ferme restait à faire. A l’époque, c’était Jean Derrien (le barde breton) et Eugène Bellec, de Hent-Meur qui faisaient les cercueils. Il y avait trois classes d’enterrements. Les plus pauvres avaient une messe à 9 heures ; d’autres à 9 h 30 et la cérémonie religieuse la plus cotée était à 10 h 30, comme la grand-messe du dimanche… Je vais te dire exactement pourquoi mon père a cessé cette activité. Par moments, il en avait assez. Comme ce jour où il est allé avec son cheval Bayard chercher le corps de la Mère Le Saux à Cabatous. Il y avait de la neige et du verglas. Il avait eu du mal à assurer le service. Jean Le Saux, le fils de « Jobic » du Stivel, travaillait chez nous. Il devait aller chercher des andouilles et du lard à Kérizout où on avait tué le cochon. Jeanhic nous dit : « Comme c’est jour de carnaval, je vais me déguiser pour aller là-bas. On va rigoler un coup. Il est parti à vélo. Et juste en sortant de Kerloas, il a heurté une moto qui descendait de Pen-ar-C‘hoat. Il est rentré chez lui plutôt KO. Le lendemain matin, quand sa mère a voulu le réveiller pour aller au mariage d’Yves Morin, Jean ne répondait pas. Il est resté quelques jours dans le coma avant de mourir à l’hôpital de Lannion. Ca devait être fin des années 50 ou un peu plus tard. La mort de Jean, à l’âge de 26 ans, a écoeuré mon père. Du coup, il a arrêté d’assurer les convois funèbres… »
Madame Morin m’a confirmé que ce jour, le jour de son mariage, était le 17 février 1958…
A cette époque, on portait le deuil. Les femmes et les filles s’habillaient de noir. La coutume était : un an pour un parent proche et de 3 à 6 mois pour les grands-parents ou des oncles et des tantes ! Les hommes portaient un crêpe, un petit bandeau noir au col de leur veste. Durant toute cette période, il était recommandé de respecter certains principes : ne pas écouter de la musique. Ce qui n’était pas trop dur à accepter puisque peu de foyers possédaient un poste radio. Il n’était pas question non plus d’aller au bal durant cette période d’observance du deuil. Les plus malins réussissaient à détourner la règle et à donner un petit coup de canif dans le contrat en allant s’amuser assez loin de Louannec. Là où ils ne rencontreraient personne de leur connaissance. Sinon, c’était : « On a vu un tel au bal l’autre jour. Pourtant son oncle Albert n’est mort qu’il y a deux mois ! etc… etc… »
(Recueilli en 2018 auprès de Marie-Renée, épouse Le Bivic)
ENTRETIEN AVEC MARIE-THÉRÈSE DE KERLUCUN… Une agréable « Koazeadenn » (= Conversation)
Elle a la patate. Une pêche d’enfer, Marie-Thérèse Lojou, 90 ans ! Alimentée par une pile Duracell, cette Marie-Thérèse, épouse Le Maguer ! Nous avons passé plus de deux heures auprès d’elle, chez elle à Kerlucun, sans voir le temps s’écouler. Nous sommes passés du coq à l’âne, d’hier à aujourd’hui. Sans aucune transition…
Je connaissais Marie- Thérèse depuis toujours. Elle me dit tout de go : « Ta mère Thérèse nous avait organisé un Réveillon en 1946, chez toi, à Mabiliès ! » J’avais 2 ans et je ne peux avoir le moindre souvenir de cette soirée…
Nous suivrons donc les pas de cette femme, issue d’une fratrie de 8 enfants. Une fratrie qui a connu la vie dure, des jours meilleurs comme nous le raconte cette fringante nonagénaire…
Nous sommes dans les années 30. Au mitan de la période qui sépare les deux guerres mondiales. La France vit une période trouble marquée par une crise économique grave. Industrie et agriculture sont au plus bas. Cette situation entraîne une crise politique au plus haut de l’Etat de la Troisième République…
A Kerambellec, à Louannec, on vit de loin cette situation politique. Marcel Lojou, 38 ans, le père de Marie-Thérèse, est victime d’un coup de froid. Il a travaillé dur à l’arrachage d’un champ de lin. Il n’a pris les précautions suffisantes pour se protéger des aléas du climat. Il laisse une veuve, Marie-Louise et 8 enfants en bas âge. Pour Marie-Thérèse, plus question de jouer à la poupée ni à la dînette. Elle passe sans transition aux travaux pratiques. A l’époque, il n’y avait ni pension de réversion, ni RMI, ni aucune aide quelconque. « Ma mère, explique Marie-Thérèse, est allée à la Mairie de Louannec et a dit : Si vous nous laissez comme ça, je descends à la grève de Nantouar me noyer avec mes huit enfants.. »
« Du coup, continue Marie-Thérèse, j’ai élevé mes frères et sœurs. Ma mère partait travailler dans les fermes. Pour améliorer son salaire , elle restait après le repas du soir faire des travaux de couture. Quand elle tardait à rentrer, on avait peur. Je disais alors à mes frères et sœurs : Quelle chanson vous avez apprise à l’école ? Et on chantait…Quand ma mère arrivait enfin et qu’elle frappait à la porte, je lui sautais dans les bras… A 10 ans, j’allais aussi laver au lavoir de Kerlucun qui n’était pas aussi beau qu’aujourd’hui. J’étais avec Albertine Cottel, Mélanie Rouzès, Raymonde Talbeau qui travaillait pour la ferme de Keryann Bihan où il y avait 14 enfants, 8 garçons et 6 filles. Quelquefois, le linge était gelé. Nos mains aussi… Ma mère disait : Ce n’est pas une fille que j’ai, c’est un garçon ! »
En plus de gérer les tâches du foyer, il fallait aller à l’école. « Ma première maîtresse a été Mme Cornec, continue cette jeune chargée de famille. Après, il y a eu Melle Le Calvez de La Roche-Derrien. Elle ne me faisait pas de cadeaux, celle-là ! Il fallait que je lave sa voiture, que j’astique son buffet. Elle voulait que j’arrive avant les autres le matin pour allumer le poêle. Je lui disais que j’avais beaucoup de travail à la maison… Nous avons toutes été reçues au Certificat d’études. »
Marie-Thérèse Lojou a travaillé pendant deux ans au Bar Restaurant Gouriou : « Il fallait bien servir tout le monde, dit-elle. Quelquefois, il y avait en même temps des clients d’ici et des Allemands… Il ne fallait pas avoir les deux pieds dans le même sabot. On m’appelait Trottinette. J’allais de la cave, au rez-de-chaussée, à l’étage faire les chambres. Il fallait sortir les eaux usées dans un seau et rapporter de l’eau potable. Oh oui, je ne chômais pas… »
Est-ce que les touristes de l’époque étaient généreux ?
« Ils ne laissaient pas de pourboire. En revanche, ils avaient l’habitude d’offrir le champagne à leur départ. Tu te rends compte, je n’avais jamais bu ça, moi ! »
Au sujet de l’Occupation allemande, Marie-Thérèse raconte :
« Eh bien, non, je n’ai pas vu les Américains passer à Louannec en 1944. Avec les années d’Occupation, chacun avait appris à ne pas être trop curieux. Personne ne connaissait l’issue de l’aventure…
On avait bien vu les Allemands partir car, dans le quartier de Kerlucun, ils avaient réquisitionné des charrettes, des chevaux et même des charretiers dont mon frère Jean… Grand feu de joie au bourg et un drapeau tricolore sur le clocher. Eh oui, mais les Allemands sont allés jusqu’au Cruguil et puis, demi-tour. Ils sont revenus, plus menaçants que jamais. Il a fallu se ramasser, vite fait !
Par contre, j’ai vu des Annamites. Ils travaillaient pour les Allemands qui les logeaient dans un baraquement au bourg, près de l’école. Et nous, nous passions les voir. Il fallait bien qu’on sache à quoi ressemblaient des prisonniers puisque nous tricotions pour eux de grands cache-nez kaki ! Ces Annamites, arrivés là par je ne sais quel hasard, nous effrayaient un peu avec leurs dents noircies. Par quoi ? Pourquoi ? Est-ce qu’ils avaient plus que nous à manger ? En tout cas, ils cultivaient un champ, du côté de Roc’h Gwenn, pour avoir quelques légumes…
J’ai vu aussi, vers la fin de la Guerre, ceux qu’on appelait les Russes Blancs. Ils ont laissé le souvenir de personnages frustres et cruels. Ils n’hésitaient pas à rentrer chez les gens pour réquisitionner du lard, des andouilles, des patates, des vélos… C’est simple, ils réquisitionnaient tout… De l’avis général, ceux-là étaient pires que les Allemands..
Comme j’étais l’aînée de 8 enfants, j’étais responsable de mes frères et mes soeurs. Je devais les ramener à la maison après l’école, surveiller les devoirs des petites. A la maison, la soirée se passait à attendre ma mère.Les fenêtres étaient calfeutrées à cause du couvre-feu. Une lampe à pétrole était posée au milieu de la table. Et ma mère qui n’était pas rentrée. Restée veuve très jeune, après des journées à travailler dans les champs, elle enchaînait après le repas du soir par des travaux de couture. Pour avoir quelques sous en plus…
La vie était dure en ce temps-là. Le pain était rare et souvent mauvais. Les patates et le lait ribot étaient notre plat principal. Nous réussissions à survivre grâce à l’entraide et à la générosité de nos voisins..
Il y avait beaucoup de maladies : la diphtérie, la tuberculose, la fièvre typhoïde, la furonculose et la gale après le retour des prisonniers. Ma mère faisait la garde-malades un peu partout chez les autres…
Tous les soirs, on entendait passer la patrouille allemande : ein, zwei, drei ! Ils marchaient au pas avec leur fusil et leurs chiens. Où allaient-ils ? Sans doute jusqu’à Perros ?
Quelquefois, pendant la nuit, on entendait passer des avions. Aussitôt après, la DCA commençait à canonner. Il y a même un avion allemand qui est tombé à côté de Kerjean…
Après l’armistice, on a eu encore des moments difficiles. On manquait de tout…
J’ai gardé longtemps chez moi une paire de chaussures que P’tit Campion avait laissées. Il partait au maquis : « Je marche mieux avec mes sabots, disait-il. Je les prendrai à mon retour. » P’tit Campion n’est jamais revenu. Il a été tué ce jour-là quelque part à côté du Guillors. Il avait 20 ans. C’était le 9 juin 1944… »
« Après la Guerre, quand sont arrivés les premiers tracteurs, je me suis dit qu’il n’y aurait plus besoin d’autant de monde dans les fermes. Je suis partie Paris où j’ai trouvé du travail chez Olida, puis plus tard dans un Lycée et enfin comme nounou. J’ai dit aussi à mes frères et sœurs : Allez hop, venez par là ! Il n’y a que Jean qui est resté à Kermaria-Sulard et Marcel à La Roche-Derrien. Trois de mes frères et sœurs ont été embauchés chez Denin, une entreprise qui faisait des accumulateurs. J’ai épousé Jean Le Maguer qui travaillait chez Talbot. Nous avons habité à Levallois, à Argenteuil et à Poissy. Nous avons eu trois filles. Nous avons fréquenté un club de Bretons où nous allions à des bals et à des sorties. Nous aimions danser. Un jour, à Louannec pendant nos vacances, nous avions été premiers d’un concours de danses. Ex-aequo avec François L’Hévéder. François n’était pas content ! »

avant de revenir s’installer à Louannec.
Combien de fois, durant toute ces années parisiennes, Marie-Thérèse et Jean ont emprunté la RN 12 pour venir se ressourcer l’espace de leurs congés payés à Kerlucun. Ils ont passé des heures dans les bouchons de la circulation lors de la traversée de Saint-Brieuc. Le ralentissement commençait à Yffignac pour se terminer une fois montés les lacets de la côte de Trémuson !
La famille Lojou illustre très bien ce qu’on a appelé « l’exode rural », le départ des gens de la campagne vers les villes. L’agriculture commence à s’industrialiser avec l’arrivée des tracteurs et des moissonneuses-lieuses. Il n’y a plus assez de travail pour les familles nombreuses de l’époque alors que les usines des grandes villes demandent de la main d’oeuvre.
Après une jeunesse aussi chargée de responsabilités, après une vie de travail à Paris est venue l’heure de la retraite. Retour case-départ, bien sûr. Dans un confort et dans des conditions matérielles qui n’ont rien à voir avec celles d’une jeunesse vécue dans une totale pauvreté. « J’ai trouvé un peu dur quand même au départ, avoue Marie-Thérèse, parce que mes filles et mes petits-enfants étaient restés à Paris. Mon mari a pris sa retraite à 55 ans. ». Et puis, il y a pour voisine une de ses sœurs, épouse de Marcel Rault.
La vie à Louannec s’articule en partie autour des activités de l’ARAL : « Depuis 1982, j’ai fait au moins 20 voyages avec l’ARAL… » Quand il faut apporter un peu de bonne humeur lors de ces sorties, Marie-Thérèse entonne « La Java bleue » ou « Il est un bal musette » repris en choeur par l’ensemble du groupe…
COMMENT VIVAIT-ON DANS LES ANNÉES 50 ? LE LIEU DE VIE À LA FERME…
Quand nous étions enfants dans les années 50, nous n’avions pas de fil à la patte. Nous partions, jusqu’au repas suivant « à l’aventure » sans aviser nos parents de notre destination. La connaissions-nous nous mêmes ? En période de battage, nous nous mêlions à l’escouade des travailleurs. Dans l’espoir de bénéficier du repas pantagruélique du jour : poulet rôti ou lapin en sauce ! Fallait-il faire une commission ou une course, nous devenions messagers. Le maître d’école nous remettait-il des timbres à vendre pour « les Pupilles de la Nation », nous partions aussi loin qu’il le fallait pour tenter d’obtenir le titre de meilleur vendeur de la classe ! Les fermes, c’était un peu notre territoire. On y allait souvent apporter notre contribution : quand il fallait planter les pommes de terre (on disait « semer »!), quand il fallait les ramasser, quand il fallait planter les betteraves, des navets, plus rarement des choux (on disait « piquer »), quand il fallait les arracher, quand il fallait retourner le foin à la fourche pour le faire sécher, quand il fallait entasser les gerbes de blé en javelles, quand il fallait retourner le lin qui rouissait sur un pré avec une longue perche, etc… etc… C’est curieux, ces années-là, personne à Louannec ne cultivait ni choux-fleurs ni artichauts. Les Léonards n’avaient pas encore initié les Trégorrois à ces récoltes plus rémunératrices… On avait besoin de toutes les mains pour les travaux des champs, l’agriculture était loin d’être mécanisée…
Les fermes à Louannec, nombreuses à l’époque (plus de 120, aujourd’hui moins de dix!), on les connaissait. D’ailleurs, la porte était toujours ouverte. L’accueil était chaleureux. En cette époque où la télévision n’existait pas ni le téléphone à domicile, où les postes de radio n’étaient pas nombreux, l’arrivée d’un « étranger » était la bienvenue. Toujours quelque chose à dire, une information à apporter sur un tel ou sur une telle… L’information circule sur un mode « téléphone arabe »…
Essayons de décrire le lieu de vie-type d’une ferme dans ces années-là. C’est la grande pièce où la famille et les journaliers prennent leurs repas ensemble. Le sol est fait de ciment avec de petits points. Au dernier moment, avant que le mortier ne durcisse, le maçon a passé une roulette dentelée sur toute la surface. Souvent, le sol est en terre battue. J’ai vu des endroits où, d’un côté, celui du maître de maison, il y avait du cidre bouché et de l’autre, du côté du personnel, du cidre plus ou moins frelaté ! Ce lieu de vie est une pièce où s’affaire du matin au soir, entre la traite des vaches, la maîtresse de maison.
Ce qui frappe en y entrant : c’est tout un pan de mur, un côté sur toute sa longueur occupé par un ensemble de la même fabrication, un ensemble qui sent l’encaustique. Il y a un lit clos avec un voilage. C’est le lit de la mémé. Puis une armoire où sont rangés draps, torchons, serviettes et …les économies de la ferme. Dans une boîte rouillée que l’on croit aussi à l’abri que dans un coffre-fort suisse! Vient ensuite une horloge au tic-tac régulier. Sur le balancier, deux gerbes de blé et une faucille. Aucune allusion au « marteau et à la faucille », cette horloge a été conçue avant 1917, l’année qui avait installé le communisme en Russie ! Sur le cadran en émail blanc, des chiffres romains et cette inscription « Horlogerie Cuziat. Lannion ». En bout, pour compléter ce quatuor, un dernier meuble, le buffet qui contient vaisselle et victuailles. Les fenêtres sont soit vitrées soit closes par un voile grillagé. Il en interdit l’entrée aux mouches qui ont échappé au ruban collant qui pend au plafond et sur lequel se débattent et s’épuisent quelques compagnes, piégées, engluées dans la colle, en fin de vie…
En face en entrant, une cheminée. Sur le rebord, deux obus de cuivre sculptés par les Poilus dans les tranchées entre deux attaques meurtrières. Comment a-t-on pu conserver comme des trophées ces maudits explosifs qui ont coûté la vie à près de cent jeunes gens de la commune ? Sur le manteau, en hauteur, un crucifix. De taille à géométrie variable. Il donne une indication de la hauteur de la foi et de la pratique religieuse de la famille. On y voit accroché un rameau de buis dont les petites feuilles commencent à sécher. Il est là depuis le dimanche des Rameaux, jour où il a été béni lors de l’office… Auprès de la cheminée, un fauteuil où Mémé ronronne comme le chat qui dort auprès d’elle. On ne connaît pas encore l’EHPAD…
A gauche, ronfle du matin au soir et du soir au matin un fourneau. On l’alimente au charbon ou au bois ; c’est selon. C’est la seule pièce chauffée de la ferme. Sur le feu, en permanence, une bouilloire remplie d’eau. Si quelqu’un arrive, tout est prêt pour servir un café. Au-dessus du fourneau, des étagères encombrées de casseroles, de poêles. Des louches et des écumoires pendent contre le mur… Auprès du fourneau, un seau rempli d’une eau que l’on a retirée du puits voisin…
Cette grande pièce est occupée par une longue table, la table commune avec un banc de chaque côté. En bout de table, un profond tiroir où s’entassent d’énormes miches de pain que l’on s’est procuré en échange de bons en carton (tant de farine apportée au boulanger, tant de cartons). Quand on n’a pas cette huche, on pose les miches sur une planche à pain accrochée au plafond. Quand elle entamera la miche, avant de couper le croûton, la fermière tracera avec la pointe de son couteau le signe de la croix sur la partie plate de la miche. Là-haut, à côté, pendent deux grosses tranches de lard accrochées par deux ficelles à une branche de coudrier. Ici des andouilles et des saucisses que l’on préparera un jour de fête…
Sur le mur, à gauche, entre les fenêtres de la façade, un diplôme : le certificat d“études obtenu par le maître de maison, il y a bien longtemps. Sur ce parchemin, on devine l’escalier de Brélévenez et quelques sites remarquables du département des Côtes du Nord. Ici, une sorte de création qui se veut artistique avec des épis de blé, des fleurs séchées. C’est un souvenir de la dernière Mission. Une Mission, c’était une séquence durant laquelle venaient sur la paroisse des prêtres issus d’ailleurs. Pour booster et revigorer la foi religieuse. Cette période était assortie de réunions, de veillées de prières, d’offices religieux…
Sur la cloison de bois qui clôture la pièce, l’almanach des PTT. Il y a souvent ce calendrier qu’on effeuille au jour le jour. Plus les jours et les semaines passent, plus il s’amaigrit. J’y ai vu aussi le portrait du Général de Gaulle, sa photo officielle lorsqu’il fit l’appel du 18 juin 1940 depuis Londres… Et quelquefois même des babioles, les colifichets ramenés de Perros le jour de son conseil de révision ! « Bon pour les femmes ! » était-il écrit… On motivait comme on pouvait les jeunes pour aller se faire démolir le portrait sur les champs de bataille…
Le repas, frugal (une soupe et une tranche de pain avec un peu de lard) , se passe calmement. Chacun a sorti de sa poche son couteau de marque « Pradel ». Un couteau avec lequel tout à l’heure on se curera les ongles ! Ce couteau que l’on lancera les jours de battage pour l’attribution des postes sur l’aire. Plus on est près du cochonnet, plus on a le choix ! On parle du temps à venir, des récoltes, des gens comme on le fait aujourd’hui sur Facebook ! Le personnel se montre discret. Il participe à la conversation si on l’y invite. Les enfants sont mutiques. Ils n’ont pas la voix au chapitre…
Derrière cette cloison de bois, une petite pièce qu’on appelle laiterie. Dans le réservoir de l’écrémeuse, la fermière verse le lait de la traite du jour. Elle recueille d’un côté la précieuse crème et de l’autre le petit lait qui alimentera le veau qui vient de naître. La crème est déposée dans la baratte qui en fera du beurre. Une partie sera mise à disposition des voisins, l’autre sera vendue le jeudi au marché de Lannion, avec quelques œufs, une poule ou un canard !
INSTALLÉ EN 1953, PIERRE GODÉ A VU AU COURS DE SA CARRIÈRE LA DISPARITION DE L’AGRICULTURE TRADITIONNELLE…
Marie et Pierre ont en main un patrimoine qu’ils savent faire fructifier. Dans les années 50, une ferme de 15 hectares avec 3 chevaux et 20 vaches laitières, c’était quelque chose. Mais, une dizaine d’années plus tard, le Ministre de l’Agriculture Edgar Pisani tire la sonnette d’alarme : la Bretagne paysanne a 50 années de retard sur les autres régions de France. Va commencer un long processus qui va bouleverser l’agriculture régionale et par le fait locale. Les mesures mises en place sont le remembrement des terres, les primes au départ à la retraite, etc… En fait, Pierre va vivre la transition entre une agriculture basée sur la polyculture qui est jetée aux orties. Il y avait alors 120 fermes sur le sol de la commune, il y a aujourd’hui moins de 10 !
Malgré tout, Pierre sait sortir du train train dans lequel beaucoup de vos camarades se se sont embourbés. Assez tôt un tracteur Pony vrombit dans la cour de Goasmorgan et notre cultivateur trace sa route.
Il produit des choux pommés pratiquement labellisés puisqu’on les appelle « kaol Godé », ce qui veut dire « les choux spécialité de Godé » ! Les choux de Goasmorgan partaient sur Paris ou encore vers l’Allemagne par l’intermédiaire de la Coopérative de Landerneau. Parallèlement, Pierre sait tirer son épingle du jeu en vendant directement ses récoltes de choux, de radis, de salades à la grande surface Géant de Lannion.
UNE DOUCHE, GESTE NATUREL ET SIMPLE, AUJOURD’HUI. OUI, MAIS CE N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ LE CAS…
Quoi de plus agréable au lever que de prendre une bonne douche ? Pour se remettre d’aplomb si on s’est levé du pied gauche… Une promenade à marche rapide ? Petite douchette au retour… Une suée dans les travaux du jardin ? Idem… Tout ceci est simple comme bonjour aujourd’hui. Mais il faut bien l’avouer : ça n’a pas toujours été le cas…
On a eu l’occasion de le signaler. Au début des années 50, il n’y avait pas dix voitures automobiles à Louannec – plus de 2500 aujourd’hui !-. Seuls les ménages aisés pouvaient se payer le luxe d’une voiture. Et sur ces dix familles, combien avaient-elles une salle d’eau équipée d’une douche ? Une ou deux, encore pas sûr… A l’époque, les habitations n’étaient pas conçues pour et en plus elles n’étaient pas desservies en eau courante. Le château d’eau de Mabiliès, alimenté par la source de Kergrist, a été inauguré en mars 1955…
A cette époque, salles de bain et WC n’étaient programmés que dans les habitations nouvelles. Pour l’anecdote : Titig Trémel avait eu sa maison de Nantouar incendiée par les Allemands pendant l’Occupation. Quand elle fut reconstruite sur dommages de guerre au début des années 50, Titig eut cette répartie à l’encontre de l’architecte ou du maître d’oeuvre : « Les salauds, ils ont mis les chiottes dans la maison ! » Nostalgie de la petite cabane au fond du jardin…
Pour ma part, j’avais 4 ou 5 ans, quand j’ai vu -pas quand j’ai pris!- la première douche de ma vie. C’était à Kerscouac’h chez Pierre Saliou dans son habitation au style normand avec des colombages en trompe l’oeil. A côté de cette belle demeure ronflait le moteur du teillage de lin qui avait été mécanisé. Bâtiment enfoui aujourd’hui sous une épaisse végétation. En découvrant cette salle de bain, j’ai eu un mouvement de recul. J’avais dû entendre parler autour de moi et faire l’amalgame avec les douches malfamées qui firent la triste renommée des camps de Dachau et de Buckenwald.

de lin attenant. C’est là que j’ai vu la première douche de ma vie.
Comment se lavait-on dans les campagnes ? Toilette de chat jour de semaine et de temps à autre la grande toilette. Un seau d’eau, torse nu et vas-y que je te… Pour les grandes occasions, nous les enfants, on nous plongeait, nus comme des vers, dans l’eau tiède d’une lessiveuse habituellement destinée à bouillir le linge au retour du lavoir…
Ces années-là, comme il n’y avait pas encore de stade municipal à Louannec, on délimitait une aire de jeu dans un pré que les vaches venaient de tondre avec leur langue râpeuse. Les joueurs se changeaient au coin du champ, et rangeaient leurs vêtements du dimanche dans une camionnette. Après le match, il fallait bien se décrasser surtout quand le terrain était gras. Les 22 joueurs devaient se contenter d’une auge métallique, un abreuvoir à vaches alimenté par une tonne à eau ! Chez eux, la toilette aurait été la même puisque chacun s’alimentait en eau au puits de sa ferme…
Quand fut construit le stade municipal, ce ne fut guère mieux. A l’extérieur des vestiaires minuscules, il y avait un bac en béton et au-dessus deux robinets : un pour chaque équipe !
Quand les nouveaux vestiaires furent construits au début des années 60, des douches furent enfin installées. Elles furent même ouvertes au public le dimanche matin sous forme de douches municipales …
Dans une étude que j’avais faite sur Louannec cette année-là, j’avais signalé cet avantage offert à la population de Louannec. Je devais présenter ce travail devant une commission présidée par M. Renard, un p’tit bonhomme qui était le directeur très craint de l’Ecole Normale de Saint-Brieuc. Il y aurait à ses côtés Antoine Mazier, Maire de Saint-Brieuc, proche collaborateur de Michel Rocard quand fut créé le PSU (Parti Socialiste Unifié). Il était notre professeur d’Histoire et Géographie. Un autre professeur -prof de math qui était aussi le propriétaire de l’Hôtel-Restaurant de La Plage à Saint-Michel en Grève- avait le rôle de m’assister ce jour-là. Son établissement trégorrois tournait du feu de dieu. On ne connaissait pas encore la pollution par les algues vertes dans la Baie. Celui-ci vient me trouver huit jours avant la présentation et me demande de supprimer la phrase suivante : « Comme il y a maintenant des douches au Stade municipal, les habitants de la commune qui le souhaitent peuvent venir prendre leur douche dominicale ». Mon « tuteur » craignait que mon texte – « douche dominicale » ne choque un jury citadin, loin de cette réalité ! « Pas question, lui ai-je répondu. C’est comme ça. Un point c’est tout ! »… M. Renard, le jour de mon exposé, ne s’est pas appesanti sur cette douche dont étaient privés la très grande majorité des Louannécains. Lui-même disposait d’un logement de fonction confortable mais peut-être était-il issu d’un milieu rural ? A contrario, il se montra intéressé par la présentation que je fis du Foyer Rural. Quelques mois plus tard, j’appris de la bouche d’Yves Crocq, secrétaire de mairie, que M. Renard avait loué la salle pour organiser une soirée au bénéfice de l’association qu’il présidait, le Lion’s Club, je crois…
J’ai aussi le souvenir en 1966 et en 1967 d’aller faire mes ablutions au bloc sanitaires de Trestraou, tout près de l’actuelle antenne de l’Office du Tourisme !
Le mot douche évoque pour moi aussi un autre souvenir. Triste, celui-là !… Notre groupe de sportifs se rendait en excursion depuis Nazareth, ville où nous étions basés dans un kibboutz, au lac de Tibériade. Shimon Suissa dont nous étions les invités, était notre guide. Alors que nous roulions sur le plateau du Golan, Shimon, ému, dit à son fils : « Ici, pendant la Guerre de Kippour, j’ai passé 15 jours à charger des cadavres dans un camion. 15 jours sans même pouvoir prendre de douche ! » Cette fois-là, en 1973, les Israéliens s’étaient laissés surprendre. Les Syriens avaient profiter qu’en Israël on était en train de célébrer dans les synagogues le jeûne de Yom Kippour pour passer à l’attaque. Depuis ce jour, toutes les heures sur les ondes est passé un message sur les risques d’attaque ou pas… Le soir de cette excursion, on apprit qu’un Premier Ministre français avait mis fin à ses jours. Nous avions hâtivement déduit que la victime pourrait être Laurent Fabius, en proie ces semaines-là à de graves accusations dans l’affaire du sang contaminé qui faisait grand bruit. En fait, nous apprîmes le lendemain qu’il s’agissait de Pierre Bérégovoy…
Nous avons évoqué récemment les conditions de vie inhumaine pour les Poilus dans les tranchées. Pour eux, la douche, n’en parlons même pas !
La douche à l’internat de Saint-Joseph de Lannion où j’ai fait mes études secondaires, c’était un poème. Pendant les récréations, nous nous adonnions à des parties de football endiablées que nous terminions, au son de la cloche, tout en sueur. Pour nous remettre propres comme des sous neufs, nous bénéficiions d’une ou de deux douches par trimestre. Oui, par trimestre ! Ce jour-là, on se rendait dans un grand local, un peu semblable aux douches municipales de Lannion qui se trouvaient à cinquante mètres de l’autre côté du grand mur d’enceinte de l’Institution. Chacun avait sa serviette et sa savonnette et la cérémonie se déroulait au sifflet de l’Abbé Danic, préfet de discipline. Pour gagner du temps, on se mettait en petite tenue avant de gagner chacun son box respectif : torse poil et en calbar . Phase 1 : Coup de sifflet, on se mouille. Séquence rapide. Phase 2 : Coup de sifflet, l’eau est coupée. Il n’y a pas de petits profits ! On se savonne. Phase 3 : Coup de sifflet : on se rince et fissa ! A peine étions-nous sortis qu’une autre classe prenait le relais. Travail à la chaîne !
C’est que une ou deux douches par trimestre, c’était trop pour certains ! Oui, parmi nous, il y avait des resquilleurs… Des resquilleurs qui se faisaient « gauler » et confondre presque à chaque coup. Alors que nous étions en train de passer chemise et pull over, le Préfet de discipline passait dans les rangs pour une rapide inspection. Quand il se trouvait face à une tignasse aussi sèche qu’un jour de canicule, le fautif était démasqué. Je ne sais plus comment était réglé l’incident : passage sous le jet d’eau, probablement assorti de quelques heures de « colle » ! Le temps de réfléchir sur les bienfaits d’une bonne hygiène…
LE FONCTIONNEMENT DU DISPENSAIRE, MAISON SAINT-YVES, DANS LES ANNÉES 50…
La Maison Saint-Yves remplissait au moins deux fonctions dans les années 50. C’était une école primaire catholique ouverte aux filles seulement. C’était aussi le dispensaire de la commune. Je n’y ai pas le souvenir de retraites quelconques, les séquences que j’ai suivies dans ce cadre -petite communion, confirmation – s’étant faites dans l’église elle-même. Pour la confirmation qui avait lieu tous les quatre ans, je crois, Louannec était jumelée avec Saint-Quay-Perros. J’ai le souvenir de deux sœurs sur le site de la Maison Saint-Yves : Soeur Célestine qui était institutrice et qui assurait la partie enseignement. Et une autre dont j’ai oublié le nom, plus grande, plus sévère, qui était la responsable des soins infirmiers.
La sœur infirmière, très sollicitée, formait dans chaque quartier une aide-infirmière qui pouvait, au minimum, faire les piqûres. Bernadette, qui a tenu le café du Croajou, m’a dit qu‘ étant jeune fille, elle jouait ce rôle à Petit-Camp. A Mabiliès, la personne référente était Jeannette Bourdellès, sœur de Pierre, Député-Maire et sœur de Louis, Président de Louannec-Sports.
Cette soeur-infirmière de la Maison Saint-Yves se déplaçait à vélo. Une délibération du Conseil municipal fait état de l’achat par la commune à son intention d’un vélomoteur !
Pour situer le niveau des soins dans le secteur, rappelons qu’à l’Hôpital de Lannion, tenu lui aussi par des sœurs, il n’y avait que deux dortoirs : un pour les hommes et un pour les femmes. Tous les patients – jeunes, vieux, malades en fin de vie – cohabitaient quels que fussent leurs maux ou leurs maladies ! Cet ancien hôpital, route de Morlaix, est occupé aujourd’hui par l’ENSSAT, par une bibliothèque et par des salles de réunions.
Revenons au scénario des séances de vaccinations obligatoires au dispensaire de la Maison Saint-Yves. Nous avons récemment sur ce site publié des photos ayant trait à ces journées.
ACTE 1 : L’ANNONCE.
La mauvais nouvelle, pour nous les enfants, tombait un dimanche matin à la sortie de la grand-messe sur le coup de 11.45 heures. Comme chaque dimanche, le secrétaire de mairie Yves Crocq montait sur la pierre fixée dans le mur du cimetière d’où il diffusait les informations municipales. Il commençait par l’annonce des bans de mariage, des journées de coupe de goémon, du recensement des chevaux en cas de guerre, etc… C’est alors que nous les enfants, noyés dans la foule des adultes, devant le Bar Gouriou, prenions la nouvelle en pleine poire : « Jeudi, à partir de 9 heures, tous les jeunes nés en XX, devront se présenter au dispensaire pour la séance de vaccinations… »
ACTE 2 : L’ATTENTE DANS L’ANGOISSE.
Restaient trois jours à mijoter sur ce qui serait notre supplice ! Nous avions tous entendu les militaires parler, quand ils venaient en permission, des séances de vaccinations lors de l’incorporation dans les casernes avec des seringues grosses comme çà ! Ce qui faisait monter la pression chez nous. Les paroles rassurantes de nos parents n’arrivaient pas à atténuer notre appréhension. Mais il faudrait bien se résoudre à y aller…
ACTE 3 : DANS LE VIF DU SUJET !
Ces années-là, c’est le jeudi et non le mercredi que l’on vaquait. Pour ma part, je me rendais avec mes frères au dispensaire. On devait se mettre en file, épaule droite découverte. La soeur-infirmière officiait à un rythme effréné. Je n’ai pas le souvenir de voir changer de seringue après chaque piqûre. Je crois que la pointe de l’aiguille était passée sur une flamme pour la stériliser. C’était un peu comme dans le grand hangar de Roger Adam à Mabiliès quand on lui présentait les poulets un à un. Il y en avait des milliers ! Il leur injectait dans le cou une petite pilule qui était en fait une hormone de croissance !
Une fois vaccinés, on rentrait chez soi. Les plus grands, ceux de la classe du certificat d’études, jouaient aux braves. Je me souviens de voir Jean-Baptiste Le Fichous de Nantouar faire des ronds de bras. Tout juste si le liquide ne ressortait pas. Certains d’entre nous encaissaient bien le coup. Ce n’était pas mon cas…
ACTE 4 : DEUX OU TROIS JOURS SANS POUVOIR MOUVOIR L’ÉPAULE…
Le temps de rentrer à Mabiliès et l’épaule commençait à chauffer. Pour le soir, l’épaule était complètement ankylosée. Le moindre déplacement provoquait une très grande douleur. Il convenait donc de rester au lit, au chaud, pendant au moins trois jours. Le temps d’oublier cette galère…
NB : En 1954-1955, on avait eu droit à une séance de vaccination supplémentaire. Du bonus ! Une épidémie de variole avait fait 16 décès à Vannes. Ce qui déclencha une campagne exceptionnelle de vaccination en Bretagne.
HISTOIRE DE… HISTOIRES D’OEUFS
Lu dans « Teilleurs de lin du Trégor, 1850 – 1950 » (Editions skol vreizh) sous la plume de Daniel Giraudon : « On ne mangeait jamais d’oeufs à la ferme sauf au moment de Pâques. Les fermières préféraient vendre les œufs au marché de Lannion, le jeudi, pour en retirer un revenu. »
C’était le 9 juin 1944. Après les événements du Guillors, les Allemands fouillent toutes les maisons des environs. Les voici dans la fermette, juste en face de l’entrée du Camping et qui lui tourne le dos. Le lieu-dit s’appelle Poul Barac’h, ce qui veut dire la « Mare de Barac’h ». Entendons par là que le Lenn était sous domination de la famille seigneuriale Tournemine. Alors que la patrouille questionne Augustine Goasampis sur la présence ou non de « Terroristes », l’un des soldats, à l’écart dans la pièce servant de laiterie (écrémeuse et baratte), remplit consciencieusement son havresac des œufs qui étaient là. « Maman, maman, le Monsieur est en train de voler les œufs ! » crie Pierre, alors âgé de 7 ans…
Un de mes premiers souvenirs d’enfants, disons année 1948, c’est d’avoir pris le train à Mabiliès avec les fermières et les ménagères du quartier. Ces femmes, avec coiffes à « pitibord », avaient toutes un panier noir tressé. On y trouvait bien sûr les œufs de la semaine, du beurre et quelquefois un canard ou une poule, l’oeil étonné devant cet environnement inhabituel…
Effectivement, dans la plupart des fermes de Louannec, on ne mangeait pas d’oeufs. On restait dans le traditionnel : soupe de pain, pain beurre, patates et lard… Tomates vinaigrette et œufs durs, c’était Byzance ! Ce plat n’est apparu sur les tables qu’aux années 60… avec le début de l’élevage industriel des poules pondeuses.
Ordinairement, les ouvriers qui faisaient l’arrachage du lin (an dennadeg lin) étaient aussi bien traités que lors des battages. Dans un même secteur, chaque maison tenait à faire aussi bien que les autres. L’information à ce sujet et sur la qualité du cidre de la ferme circulait bien. Bien traités ? Pas toujours comme me l’a raconté, dans les années 70, Louis Le Calvez : « Une fois, on arrachait le lin à la tâche dans une ferme. La nourriture n’était pas bonne. On s’est dit : toi, ma vieille, tu ne vas pas t’en tirer comme ça. On a repéré tous les nids de poules et on se préparait les œufs. Le dernier jour, on est allé apporter à la fermière la ponte de la veille. Elle nous a dit : Je croyais que mes poules étaient devenues des coqs !… »
Aujourd’hui, beaucoup élèvent quelques poules qui se nourrissent des déchets ménagers et qui rendent les poubelles moins lourdes. L’avantage, c’est d’avoir sous la main des œufs gratuits et bio ! L’essentiel est de ne pas laisser le Goupil rentrer dans le poulailler. Un goupil qui joua un fort mauvais tour à Charles-Yves, détruisant complètement son élevage. Le piège prévu pour la traque au renard a neutralisé… Une quinzaine de hérissons…
« Uiou Mad » à Kerjean, c’est une très grande entreprise de productions d’oeufs qui se trouve à Louannec. A mettre au compte de la famille Rolland sous l’égide de Pierrig…
LE P’TIT TRAIN… Louis Le Luyer conduisait ce train…

« Mon père avait un autre code avec le boucher Boubennec. Celui-ci mettait son camion de travers sur la voie et ils allaient boire un coup tous les deux ! Philippe, le chef de gare, n’appréciait pas trop ! ».
Ou encore :
« Mon père m’a dit qu’un jour qu’il conduisait un train de marchandises, un wagon s’est détaché dans la côte de Kernu et a traversé Perros à toute vitesse comme un camion fou… ».
Ou encore :
« Mon père écoutait sa machine. Il me disait que le bruit était en montant la côte de Kernu : Nouké cap’ ! »
Nouké cap’ ! (=Tu ne peux pas ! Tu ne peux pas !) et, en descendant : Suk’ acafé ! Suk’ a café ! (=Sucre et café ! Sucre et café !).
Ou encore :
« Une fois, j’étais allé avec lui dans la locomotive. J’avais une tenue de petit marin comme on le faisait autrefois. Je ne te dis pas dans quel état j’étais en rentrant. Autant de lessive pour ma mère qui n’était pas contente… »
La gare de Mabiliès se trouvait à l’emplacement de l’actuel château d’eau, près des locaux des Editions Jack. Un dimanche, le 6 septembre 1936, comme il n’y avait pas de passage protégé, le train est entré en collision avec un car de tourisme venant de Tréguier. La locomotive à vapeur termina sa course contre la bascule municipale et plusieurs wagons déraillèrent. Les premiers soins furent donnés aux 9 blessés dans le débit de boissons Le Garrec qui se trouvait juste à côté. Dans un article signé Christiane Bouvier, paru dans un bulletin municipal, on peut lire : Les victimes étaient blessées aux jambes pour la plupart. Marie Le Garrec, à cours de pansements, puis de torchons, donna pour éponger le sang des blessures l’ensemble de son service de table –cadeau de mariage- qu’elle ne revit jamais ! Cause de l’accident : Connaissant les horaires du train, le conducteur du car n’avait pas marqué l’arrêt matérialisé par un panneau avec la croix de Saint-André. Malheureusement, il s’agissait d’un train supplémentaire !

Le peintre perrosien a pris la liberté de transposer sur sa toile le réservoir d’eau de la gare
de Petit-Camp que l’on voit juste au-dessus. Cette photo a visiblement servi de modèle
à l’artiste car le bâtiment en briques y est représenté trait pour trait.
Savez-vous que Mabiliès a fait la nique à Kermaria-Sulard ? Voici comment…
En 1896, dans le projet de la ligne de chemin de fer Tréguier-Lannion, le tracé passe par le bourg de Kermaria-Sulard.
1898 : On pense que « le projet passant au mitan du Bourg de Kermaria et Rumanton ne répond ni au désir ni aux besoins de toute la population de la côte »
1902 : Le Conseil municipal de Louannec rue dans les brancards. Il est appuyé par celui de Trélévern. La ligne passera par Mabiliès où il y aura une gare.
1907 : Un an après la mise en service de la ligne, nouveau vœu : il faut ouvrir la gare de Mabiliès au service de marchandises. Il est dit : « A égale distance de Louannec, Trélévern et Kermaria (population cumulée 3.357 habitants), cette station est visiblement bien placée pour desservir les intérêts agricoles et commerciaux d’une région riche et bien cultivée : pommes de terre, lin, chanvre, grèves poissonneuses et engrais de mer (goémon) si appréciés »
1920 : Pierre Bouts, négociant en produits agricoles, souhaite donner à la gare de Mabiliès le nom de Louannec. Sa demande est rejetée par l’ingénieur Hélary.
Mise en circulation en 1906, la ligne sera fermée en 1949. Elle n’aura fonctionné que 43 ans !
Source : D’après Petits Trains du Trégor (Editions skol vreizh) de Laurent Goulhen.
« LA PASSE MORTELLE DE PONT-COUENNEC »…
Le 1 janvier 1927, un choc terrible se produisit entre le train départemental et la charrette d’un boulanger perrosien, M. Hamel. Le cheval fut tué, le char à bancs réduit en miettes et le malheureux commerçant grièvement blessé. On espère toutefois qu’il se remettra à la condition qu’il n’y ait pas de lésions internes et qu’il ne survienne aucune complication… Tant que les accidentés de Pont-Couënnec ne seront que de simples mortels, voire de simples députés, l’administration continuera de dormir sur ses deux oreilles. Elle ne s’éveillera pour apporter un remède à une intolérable situation que le jour où le tramway aura réussi à écrabouiller, dans ce maudit passage, pour le moins un ministre, un sous-secrétaire d’Etat ou un archevêque… Finalement, M. Hamel, 39 ans, n’a souffert que d’une plaie sans gravité au sommet du crâne, avec courbature générale et lésions légères. C’est l’écart de son cheval au moment où il allait croiser le train, qui a provoqué la collision.
Le p’tit train n’avait pas que des amis. M. Le Bihan, propriétaire du château et du bois de Barac’h, se plaignait du nombre de feux qu’il fallait éteindre, en été, suite au passage de la locomotive qui crachait des escarbilles assassines…Le train passait au milieu de la rue Ernest Renan qui va de l’actuel rond point au Linkin. Les riverains maudissaient ce train qui avait pour eux de nombreuses nuisances. Il était bruyant. Sa fumée noircissait façades et vitrages. En été, il était pratiquement impossible d’ouvrir les fenêtres pour profiter du grand air venant de la mer…
SAVEZ-VOUS CE QU’EST « LE CONSEIL MEO » ?
L’acte essentiel du conseil municipal dans l’année est le vote du budget : quelles sont les recettes, quelles sont les dépenses, de quelles liquidités on dispose pour faire des investissements, une fois les frais de fonctionnement réglés ?… En fait, dans la gestion d’une commune, il y a deux séances du budget : 1 – le budget primitif où on prévoit les dépenses et les recettes pour l’année ; 2 – le budget additionnel ou supplémentaire où on procède aux réajustements quand on est sorti des clous du budget primitif. A Louannec, et sans doute dans les autres communes du Trégor, cette réunion importante était suivie d’un repas. Un repas si bien arrosé que les citoyens de la commune appelèrent cette journée, pour se moquer un peu de leurs élus, « le conseil meo », la soirée d’où on sort plus ou moins éméché !
Louise Simon, née Guéguen, que nous avons rencontrée récemment nous a raconté cette anecdote : « Une fois, après le repas, Auguste Adam, Yves-Marie Prat – notre père Louis et d’autres étaient aussi avec eux – sont allés chez toi, au café de Mabiliès. Ton père avait 5 ou 6 barriques cidre. (Ce qui confirme ce que disait l’autre jour Louis Le Morvan qui allait d’un endroit à un autre faire le cidre avec le pressoir de Louis Daniel)…Les conseillers disaient à ton père quand ils avaient goûté le cidre d’une barrique au robinet : On va goûter celle-ci pour voir s’il est meilleur, etc… Jusqu’au dernier fût. Ils sont rentrés à la maison vers 3 heures du matin un peu euh… »
Puisqu’il y a prescription, je peux l’écrire aujourd’hui… C’était à la fin des années 70. J’avais l’honneur, en tant qu’élu, de participer à ce conseil « meo »… A la fin du repas, Raymond Daniel dit : « Allez un petit dernier pour la route ! Venez boire un coup chez moi à Kerguéno. » On s’est retrouvé à la ferme en une bonne tablée. Je me souviens qu’il y avait Pierre Bourdellès, Louis-Claude Duchesne en tant que journaliste Ouest-France, François Nicolas qui fut Maire de Louannec par la suite pour un mandat, Jean Derrien et quelques autres. Les sujets de conversation devaient être intéressants puisque nous n’avions pas sollicité le barde de Nantouar, présent à nos côtés, pour pousser la chansonnette. Et puis nous avons quitté les lieux. Si nous avons marché de guingois, le coq de la ferme de Kergueno n’étant pas loin d’ouvrir l’oeil et de faire ses vocalises, c’est que nous avions respecté la tradition…
Je ne sais pas si cette coutume ancienne perdure à Louannec…
IL FAISAIT PARTIE D’UNE ESCOUADE DE BATTAGE DANS LES ANNÉES 50. COUP D’OEIL DANS LE RÉTRO AVEC PIERRE GOASAMPIS…
Pierre Goasampis habitait la petite ferme qui tourne le dos à la route, face à l’actuelle entrée du Camping. Le lieu dit s’appelle « Poul Barac’h » (= la mare de Barac’h où se trouve le château). De l’âge de 16 à 20 ans, Pierre a fait partie d’une « escouade » ou une équipe qui assurait le battage dans un certain nombre de fermes. Après ce fut pour le jeune Louannécain le service militaire dans l’aviation à Djibouti, puis, comme beaucoup d’autres de ses compatriotes, le départ pour Paris où il a fait carrière. Il évoque cette époque faisant un retour en arrière de plus de 60 ans…
« Ces années-là, la batteuse était actionnée à l’électricité. Plus tard, elle le sera à la locomobile, puis au tracteur. Donc, toutes les fermes qui s’alimentaient au transformateur de Kériagu s’arrangeaient pour former une « escouade ». En gros, ça faisait une vingtaine de fermes. Ca partait de chez Yffig Prigent et de chez moi. On allait jusqu’à chez Pierre Colin, Emile Campion à Kerlucun en passant par chez Boulanger, Tilly, Droumaguet, Daniel, etc… Notre entrepreneur de battage était Marrec qui se partageait le travail sur la commune avec deux autres : Edouard Nicol du Cra et Jean Le Garrec de Mabiliès… Chaque ferme fournissait un ouvrier ou deux, si c’était une exploitation plus importante. Chez moi, il y avait à peine deux heures de travail ; à Goasquéo chez François Rolland, on avait pour une journée de travail. Nous étions donc 20 ou 25 gars à bosser ensemble pendant près de deux semaines. On battait surtout du blé, de l’avoine, du seigle, de l’orge avec laquelle on faisait du café pendant l’Occupation ! On formait 3 équipes : une sur le tas de blé, une autre sur le « couf » (la batteuse) et une troisième pour porter le grain au grenier. Souvent, on jouait certains postes au couteau ! C’est-à-dire que, comme à la pétanque ou au jet de palet, on jetait une pierre à une douzaine de mètres et on lançait notre couteau. Les plus proches du cochonnet étaient prioritaires. Le tas de paille, c’était l’affaire des anciens. La paille arrivait en vrac puisqu’alors il n’y avait pas encore botteleuse. Souvent, il fallait monter un échafaudage quand le tas montait en hauteur. C’est au plus expérimenté que revenait l’honneur de donner forme au tas et de le terminer en pointe de façon à ce que l’eau ne pénètre pas à l’intérieur.
On commençait la journée à 6 heures du matin et on terminait vers 22 heures. Il y avait forcément des temps morts car les jours où on faisait 4 ou 5 fermes, il y avait autant de temps à placer le matériel qu’à battre le grain. C’est pour cela que quelquefois, on avait 5 ou 6 repas par jour. On nous servait souvent des nouilles à la sauce tomate et de la viande bouillie. Il y avait tellement de poussière que chaque quart d’heure on nous servait soit du cidre soit du vin. Avant de rentrer dans la maison pour le repas, on nous servait un verre de calva ! On vivait ces quinze jours dans une ambiance de fête. On n’aimait pas trop aller dans les fermes où le cidre n’était pas bon ! Le soir, comme il n’y avait pas de douches, on allait piquer une tête à poil dans la mer. Il y avait Zantig Daniel, Yves Pezron, Louis Tilly, Droumaguet, Eugène et Louis Morvan et bien d’autres. Même s’il y avait une assez forte consommation d’alcool, je n’ai jamais vu d’accident. Les seuls incidents que j’ai vus, c’est quand la courroie ripait. L’entrepreneur la remettait en place et l’enduisait de poix pour une meilleure adhérence. Un jour, chez Marcel Saliou, sous les dernières gerbes, on a trouvé des mulots et une couleuvre. Pour un verre de vin, René Chalony a gobé un mulot et, dans la foulée, la couleuvre… »
PS : Concernant l’anecdote de René Chalony, il m’est arrivé souvent de travailler dans les champs avec lui. Un jour, à Park ar Nod, on arrachait des pommes de terre. René travaillait au croc et moi je faisais équipe avec lui au ramassage. Je lui ai demandé pourquoi il pouvait avaler toutes sortes d’animaux. Il m’a donné l’explication : « Pendant l’Occupation, j’étais dans une des îles anglo-normandes où les Allemands avaient fait le blocus. C’était la famine. On mangeait tout ce qu’on trouvait » Pour ma part, je l’ai vu avaler des mulots lors des battages, une vipère et un rat empoisonné au moment de la construction du château d’eau en 1954. Toujours pour une bouteille de Santa Rosa…
Dans le même ordre d’idées, j’ai entendu le témoignage d’un Lannionnais qui parlait de son retour d’un des camps de concentration en Allemagne : « Quand le train s’est arrêté, on a vu une grosse limace sur des feuilles de pissenlit. Je me suis battu avec un autre rescapé comme mou pour pouvoir la manger. »
Dès que la batteuse s’installait dans une ferme, nous les enfants nous rappliquions. Transporter la balle (résidus qui enveloppent les grains) dans un coin de la cour était le travail qui nous était réservé. La balle d’avoine était douce et soyeuse. On en gardait pour remplir les sacs qui garnissaient les lits à la manière de matelas. La balle de blé était rugueuse, celle d’orge très piquante avec ses barbes séchées. Nous venions à la ferme avec l’espoir de profiter du repas de fête servi ce jour-là. Rares étaient les fois où nous n’étions pas conviés au « festin ». Souvent même, il y avait un deuxième service pour les enfants. On repartait même le plus souvent avec un petit pourboire. A peu près 20 fermes, c’était ma saison de battages !
LA FABRICATION DU CIDRE À L’ANCIENNE…
« Blev a zo e-barzh ar weien avalou ! » quand les anciens tenaient ce langage, c’était bon signe ! L’espoir pour eux d’une bonne récolte et, par corollaire, l’espoir d’un cidre gouleyant qui coulera dans les tasses et dans leur gosier. Cette phrase en breton signifie : « Il y a des fleurs en abondance dans les pommiers ! »
Le jour où l’on faisait le cidre, était un grand jour. L’entrepreneur – Louis Le Morvan chez nous à Mabiliès- arrivait tôt le matin avec son pressoir tiré par un cheval. En ces années 50, le cheval était omniprésent. C’est lui qui tirait la charrue, le chargement de foin ou de gerbes de blé. C’est lui qui, à la force du jarret, hissait le chargement de goémon, en haut de la côte de Pen an Hent Nevez. C’est lui qui, au trot, tirait la calèche quand on allait rendre visite à des amis dans la commune voisine. C’est lui qui menait le corbillard jusqu’à la dernière demeure du défunt… Une fois l’an, tous les chevaux de la commune étaient rassemblés auprès de la mairie pour être recensés. Risque de guerre oblige ! Aujourd’hui, plus de chevaux si ce n’est pour une activité de loisirs. Les écuries n’existent plus. Dans bien des fermes, elles ont été aménagées avec beaucoup de goût en chambres d’hôtes ou en Gîtes ruraux…
Le « jour du cidre », une fois le matériel en place, le concasseur se mettait en route. Les pommes y étaient déversées avec des pelles profondes ou des mannes. Elles étaient aussitôt broyées. Un autre travailleur passait cette mixture dégoulinante de jus sur le pressoir.,. Louis échafaudait le tout avec précision : une épaisseur de pulpe écrasée, une couche de paille d’avoine, une épaisseur de pommes, une autre de paille et on montait ainsi jusquà deux ou trois mètres. Les brins de paille qui dépassaient étaient coupés avec un sécateur. Dès que le jus commençait à couler dans le réceptacle, une barrique coupée en deux, abeilles et guêpes venaient s’abreuver au précieux nectar. Les enfants aussi, avec une longue paille d’avoine, ne manquaient pas de goûter le liquide doux et sucré…Avec ennuis gastriques à la suite pour les plus gourmands ! Le liquide frais était déversé avec l’aide d’un grand entonnoir dans les barriques dont on ne bouchait pas l’ouverture. Les jours suivants commençait la fermentation et une mousse épaisse et blanche sortait et coulait sur les flancs des barriques…
Quand le fruit avait été pressé une première fois, on procédait à un deuxième tour avec un moût arrosé d’eau. L’édifice monté par Louis tenait mieux pour cette deuxième opération…
Ces journées de fabrication du cidre s’éternisaient jusqu’à pas d’heure. Quand la nuit était tombée, on installait une lampe baladeuse. Les travailleurs tiraient et poussaient sur la barre qui serrait le moût dans un agréable cliquetis. Il leur arrivait de se marcher sur les pieds !
Plus tard est arrivé le serrage avec une vis hydraulique. L’entrepreneur, d’une seule main, actionnait un levier de loin plus efficace que la force cumulée de quatre hommes. Cette nouvelle technique permettait d’obtenir 800 litres de jus pour une tonne de pommes. Beaucoup plus efficace puisque, peu de temps avant, pour le même poids on n’aurait extrait que 500 litres ! Méthode plus efficace certes, mais pour moi le job avait perdu une bonne partie de sa poésie… Et il n’y avait plus la musique de ce cliquetis…
VOUS SOUVENEZ-VOUS DE CES CLAPIERS ? NE RIEZ PAS ! ILS ONT RÉVOLUTIONNÉ L’ÉLEVAGE DU LAPIN DOMESTIQUE…
Je ne sais pas qui a inventé le concept de ces clapiers à lapins, si c’est une création trégorroise. Je sais simplement que celui qui a eu cette idée, n’a pas fait une mauvaise affaire ! On en voyait partout, ce type de constructions sommaires et pratiques faites de quelques plaques en béton et d’une grille en guise de fermeture. C’était un des produits qui sortaient bien aux foires agricoles, comme celle de Guingamp, la plus réputée dans l’ouest du département…
Aux jeunes que nous étions revenait généralement la tâche de nourrir les lapins… Pour ma part, je prenais un sac en toile de jute – un sac à patates – , un couteau et je partais à travers les prés. Je ramassais des espèces de salades sauvages dont je ne connais le nom qu’en breton : des « panhez » et des « lezeged » ! Il y a sur ce site plusieurs herboristes qui sauront donner le nom de ces plantes en français et même en latin !
C’était une nourriture appréciée de nos pensionnaires à qui on mettait aussi des écuellées de son…
Dans ces années 50, on essayait au maximum de vivre en auto-suffisance dans nos campagnes. Dans presque chaque foyer, il y avait un petit lopin de terre pour les légumes ; un clapier pour les lapins ; un petit poulailler pour les poules et les œufs ; parfois même une vache…
C’est dans ces années-là qu’est également apparu le formica. Et qu’on a cassé et brûlé beaucoup de meubles anciens…
Le lapin qui était un plat courant et apprécié à l’époque, a pratiquement disparu de nos tables. Avez-vous vu souvent un menu de restaurant vous proposer du lapin, hormis en terrine ?
C’ÉTAIT LE TEMPS DES BALS DE QUARTIERS !
Louis Le Goffic, épouse Le Ralec ; Marie Le Bellec, épouse Trémel et Anna Rolland évoquaient en 1996 leurs souvenirs teintés de nostalgie…
« Je te dis, dans les années 50, on ne dansait que lors des Pardons. Oui, là où on pouvait aller avec nos vieilles bicyclettes ! Nous, nous allions jusqu’à Pont-Losquet, Plouguiel, Penvénan. Oui, le dimanche après-midi de 14 à 19 heures. Et il fallait se dépêcher de revenir à la maison car il y avait le travail de la ferme à faire ! Quand il y avait bal à Louannec, on avait le droit d’y aller le soir. Pour le Pardon de Mabiliès ou le Pardon de Pont-Couennec. On a aussi dansé chez Marie Mao à Mézernec ou à Pen-ar-C’hoat pour le 11 novembre. Oui, mais là, ce n’était pas très agréable, il y avait trop de « vieux » après le banquet. On a dansé dans les allées de boules chez Gouriou pour la fête du Bouquet de Louannec. Il y avait du monde ! Le 14 juillet, on dansait dans les salles de classe. On y entendait les orchestres comme « les Troubadours de Barnabanec » ou « l’orchestre Le Moal » ou « Zantig Salaun ». Tous les habitants de la commune se retrouvaient au bourg pour les jeux, pour les danses ou pour boire une chopine. Là, on voyait du monde !
A cette époque-là, il y avait trois parties dans une danse et tu pouvais laisser tomber ton cavalier au milieu de la danse s’il ne te plaisait pas ! Quelquefois, j’ai vu des filles se faire gifler à cause de ça ! Il n’était pas convenable laisser choir un cavalier. « J’espère que tu ne te permets pas de faire ça ! » disait ma mère.
Tu parles d’un changement quand on a ouvert le Foyer à Louannec. La plus belle salle, la plus grande. Mieux qu’à Lannion ou à Perros. « Vous avez de la chance d’avoir une aussi belle salle chez vous, disaient les copines, d’ailleurs là il n’y a que les gens riches qui viennent ! »
Je me souviens quand Verchuren est venu, c’était sans doute, le jour de l’inauguration en 1956. La veille, il a fallu que je couse des robes pour moi et pour mes sœurs. On ne pouvait plus porter de vieux habits ! Il fallait porter des chaussures talons hauts et des jupes larges pour aller valser sur le parquet ciré ! Quelquefois, personne ne venait t’inviter à danser, alors tu avais le temps de regarder « Le retour des Goémoniers à Penn-ar-Garenn » ou « L’Arrivée du train à Mabiliès ».
SOUVENIRS PERSONNELS
JE ME SOUVIENS : QUAND J’ÉTAIS VACHER…
Je suis entré dans la vie active à 7 ou 8 ans… Ce n’était pas une exception. C’était le lot de tout un chacun si les parents n’avaient pas le revenu suffisant. Or, à l’époque, des bons revenus à Louannec, il n’y en avait pas beaucoup ! Tout le monde ou presque tirait le diable par la queue, comme on dit… On ne pouvait pas se plaindre puisqu’on ne connaissait pas autre chose… C’est à la ferme – en périodes de vacances, bien évidemment – que j’ai fait cette intronisation « dans le monde du travail ». J’ai commencé par le bas de l’échelle. Le premier échelon était celui du vacher ou même apprenti vacher. Ce récit n’est pas seulement mon histoire, mais celle de presque tous les camarades de mon âge. Ce texte serait-il cru par les jeunes d’aujourd’hui ? J’en doute… En cette période d’après-guerre, tout le monde voulait ou devait se rendre utile. Les oisifs n’avaient pas leur place en cette période plein emploi et de reconstruction ! Jeunes et vieux ne rechignaient pas à apporter leur concours aux travaux des champs. Les cultivateurs – environ 120 à l’époque sur le territoire de Louannec – trouvaient de quoi occuper tout un chacun. Fort ou faible, il y avait une tâche qui correspondait à la taille des bras de chacun… Le jour où j’ai « embauché », c’était pour garder les vaches. La clôture électrique n’était pas encore en usage dans la campagne trégorroise. De quelle année d’ailleurs date cette invention ? Le jour où on m’a jugé apte à la fonction, je me suis retrouvé dans une « lanneg » (un espace à moitié lande et à moitié pré), au-delà du bois de pins qui existe toujours à quelques hectomètres du château d’eau de Mabiliès. A l’orée de la pinède rouillait une carcasse de « Traction Avant ». Comme celles d’où l’on voit surgir, dans les films des années 40, des policiers SS, chapeau, longue gabardine et pistolet au poing. Tout autour de cette relique de l’industrie automobile naissante, un amas de ferraille dans un territoire que se disputaient ronces et orties. A l’époque, n’existait pas la clôture électrique, on l’a dit, la déchetterie non plus… Mon rôle était on ne peut plus simple : éviter que les bêtes n’aillent « voler ». « Laeran » disait-on en breton! « Voler » au sens de « chaparder », d’aller dérober quelques lichettes d’herbe dans le champ du voisin. Plus grave si les bêtes faisaient incursion dans un champ de blé ou dans un champ de betteraves ! En français, le mot a un autre sens « avoir des ailes » qui conviendrait dans notre cas puisque c’est passer au-delà des frontières, du talus. Pourquoi pas ? De toute manière, le petit pâtre devait éviter des « histoires » avec les propriétaires voisins. Pour un peu que les relations soient un peu tendues dans le voisinage. Une erreur, ce serait remettre une pleine louche d’huile sur le feu… Ce premier jour de garde, je me suis senti coupé du monde. C’est curieux que, quand on est jeune, on multiplie les distances par dix ! Aujourd’hui, je marche le long du Circuit des Moulins. Je longe ces champs dont je connais les noms et les moindres recoins. Ceux-ci n’ont pratiquement pas été touchés par le remembrement. Ils ont donc gardé leur structure initiale et leur forme d’alors. Je me rends compte que ce territoire que je voyais immense avec mes yeux d’enfant n’est finalement pas très étendu… Le petit vacher n’était pas très rassuré. A l’école, sa maîtresse lui avait parlé du Loup qui a dévoré le Petit Chaperon Rouge ! Du loup -est-ce le même ?- qui a détruit la maison des petits cochons. La méchante bête va-t-elle sortir du bois d’une minute à l’autre ? On a beaucoup d’imagination, à cet âge-là ! Et puis, avant le départ, il y a eu à la maison, ces recommandations : « Fais attention aux vipères ! ». Mais à cet âge, reste-t-on faire la différence entre vipères et couleuvres, plus nombreuses dans les prés… Autant un troupeau de vaches laitières est discipliné, autant un groupe de génisses est imprévisible. Il faut l’avoir à l’œil en permanence comme le lait sur le feu. Que faire pour passer le temps quand la surveillance du troupeau est sous contrôle et que l’ennui vous gagne ? Regarder la nature autour de soi. Observer les plantes, les fleurs que butinent les abeilles. Rechercher dans la verdure un trèfle à quatre feuilles pour le ramener le soir tel un trophée. Symbole de bonheur pas tout à fait acquis… Observer une sauterelle qui vous échappe, une libellule aux ailes bleutées. Attraper une grenouille gluante. Ecouter les oiseaux. Un merle au bec jaune qui siffle. Le pic-vert qui attaque un tronc : toc-toc-toc à un rythme effréné ! Dénicher des oiseaux, ce qui n’est pas mal perçu et qui est une pratique courante en ces temps-là ! Sortir de sa poche l’opinel que l’on a pour faire comme le charretier. Choisir une branche de noisetier. Découper l’écorce pour faire apparaître de jolis dessins. Attendre. Déballer ses tranches de pain beurrées et prendre son repas, en solo. Comme un soldat en campagne ! S’allonger dans l’herbe et regarder les nuages. Reconnaître dans leurs formes improbables ici un visage, là un cheval qui se cabre, ailleurs le contour d’un continent tel qu’on l’a vu sur une carte Vidal-Lablache. J’apprendrai plus tard, au cours de mes études, que je me soumettais, en observant le ciel et les nuages, à un test couramment utilisé par les psychologues. Un test au nom barbare de « paréidolie ». Après tout, Maître Jourdain faisait de la prose sans s’en rendre compte ! Se fabriquer une couronne de feuillages pour ressembler à un Empereur romain. Jules César n’était pas plus beau quand il passait sous l’Arc de triomphe à son retour victorieux de la Guerre des Gaules ! Et s’ennuyer encore et encore… Attendre l’heure de la délivrance : le retour à la ferme… Garder les vaches avec un copain, c’était autre chose. Ca devenait même agréable de garder le troupeau ! Il m’arrivait de donner un coup de main à Maurice, un jeune garçon venu à Mabiliès pour assurer le job. Issu de l’Assistance publique, Maurice venait de Paris et avait été placé à la ferme par l’Administration. On lui reprochait peut-être une scolarité chaotique. En tout cas, il aurait été capable d’apprendre, le Maurice. Sachez qu’en écoutant, en observant, le p’tit Parisien avait appris le breton en moins d’un an ! Nous avons tout de suite sympathisés et nous sommes devenus amis ? A deux, on arrivait à bien occuper le temps. Une fois, nous étions dans une prairie, à Pondolu, entre Pen-ar-Choat et Petit-Camp. Au bord du pré, coule le Truzugal. La rivière file vers le Bois et le moulin du château de Barac’h. L’herbe y est pratiquement toujours haute. Les bêtes n’ont ni l’idée ni l’envie d’aller voir si dans la parcelle voisine l’herbe est plus verte. Sur place, elles ont de quoi se remplir la panse. Il faut cependant être vigilant, il arrive qu’une vache ingurgite une plante qui multiplie les effets de la fermentation dans la panse. La vache gonfle. Il faut lancer le SOS pour que le fermier intervienne en urgence. Il enfonce alors dans le flanc de la vache en souffrance une grosse pointe, de la taille d’un couteau de boucher, appelée « trocard ». Par l’ouverture pratiquée s’échappe un trop plein de gaz et de déchets. Comme de la lave d’un cratère de volcan ! Les scientifiques n’ont-ils pas dit et écrit que la disparition de la couche d’ozone et que le réchauffement climatique seraient dus en partie aux flatulences de nos bovidés… Fort heureusement, des interventions de cette nature en urgence étaient rares. Alors, nous faisions des petits moulins en bois que l’on mettait à tourner au milieu du ruisseau. Une autre fois, nous avons tué un merle au lance-pierres. Nous l’avons plumé, vidé, embroché façon méchouï et cuit… Appétissant même s’il y avait à peine de quoi se remplir la dent creuse ! Je dois reconnaître que nous n’étions pas toujours tendres envers les animaux : gonfler une grenouille avec une paille pouvait faire partie de nos jeux. Pourtant, nous n’avions pas encore appris la fable : La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ! Faire fumer un crapaud – lui mettre une cigarette allumée dans la gueule – c’était aussi dans nos cordes ! Arracher les ailes d’une mouche ne nous posait aucun problème ! Fautes avouées, fautes pardonnées, amis de la SPA… Fumer des Gauloises que j’avais dérobées à la maison, itou. Une fois, pour écouler le stock de notre journée et pour ne pas nous faire prendre en cas d’une fouille imprévue, nous avions terminé le paquet –reste du butin – en fumant les cigarettes quatre par quatre ! Vaches laitières placides et calmes, génisses, alertes et vives comme des vachettes landaises ! Louis Bourdellès avait des champs à Goaridec, près de Petit-Camp. Une fois l’an, il fallait assurer la « transhumance » de Mabiliès à Petit-Camp. Pour ce transfert à hauts risques, nous étions généralement quatre « guides » armés de bâtons. Le premier, devant, ouvrait la route. Un de chaque côté veillait aux entrées de champs et aux accès aux fermes. Louis derrière poussait le troupeau. Immanquablement, une, deux ou trois « fofolles » nous faussaient compagnie au niveau de Kérizout. Elles emmenaient le « responsable côté gauche » jusqu’à la voie ferrée Mabiliès-Petit Camp. Une vraie corrida ! Je me suis vu un jour assis au bord du talus, en larmes, résigné, la mission devenant impossible… Plus tard, lorsque la circulation est devenue plus dense sur la route, ce transfert s’est fait dans des vans…J’avais alors quitté la profession… Quand j’ai fait mes preuves sur les tâches subalternes, j’ai pris du galon. La clôture électrique « Clotseul » avait fait son apparition dans nos campagnes. J’allais alors chercher les vaches au champ matin et soir. Je les attachais avec des chaînes autour du cou. Je me méfiais particulièrement de Bichette qui ne m’avait pas à la bonne. Je le lui rendais bien. J’assurais la traite à la machine. Je changeais la litière. Je lavais les couloirs de l’étable à grande eau. Je dessinais un tas de fumier au carré. Et, je me pressais même d’accomplir ce travail pour rejoindre les adultes au champ…
JE ME SOUVIENS DE MARIANNE GRALL… Cette paysanne a nourri au sein celui qui deviendra le Maréchal Leclerc, libératuer de Paris en 1944…
J’ai bien connu Marianne Grall quand j’étais enfant. Marianne habitait à Fospoul en Kermaria-Sulard, à la limite de Louannec. Elle venait souvent rendre visite à sa fille Yvonne, épouse Auffret qui habitait près de chez moi, à Mabiliès. Elle achetait du café, du sucre, de la chicorée à la maison. C’était dans les années 50 mais la période qui nous intéresse s’est passée un demi-siècle plus tôt… A l’époque, la vie était dure à la campagne et le salaire maigre. Après la naissance de son premier enfant, Marianne décide « d’aller vendre son lait » ou, si vous voulez, devenir nourrice. Rien qu’à Kermaria, une quinzaine de jeunes mamans, tentées par l’argent qui faisait défaut dans leur foyer, avaient choisi de faire le sacrifice de tout quitter pour des laps de temps d’environ dix mois.
Le Docteur Savidan de Lannion qui tenait un bureau de placement trouva pour Marianne une opportunité chez Madame de Hauteclocque à Charleville-Mézières à la frontière est de la France.
Imaginez le défi pour une jeune paysanne totalement illettrée : voyager seule en France d’ouest en est, avec forcément l’épreuve de la traversée de Paris. Le Docteur Savidan prit soin d’épingler sur le corsage rebondi de Marianne un carton portant ces mots : Mme prend place comme nourrice à Mézières. Prière de la renseigner car elle ne parle que breton. Merci !
Et roule, ma poule. Jusqu’à Versailles, tout est OK. Les ennuis commencent au terminus parisien de Montparnasse. Perdue dans la foule, la pauvre Marianne ne sait plus à quel saint se vouer. Elle s’assait sur un banc, sort son chapelet et se met à prier, tout en pleurs. Un homme distingué se fait bon samaritain. Il conduit la Bretonne en fiacre jusqu’à la gare du Nord et la confient à deux dames qui devaient descendre à Mézières.
Changement de décor pour Marianne pour qui commence une vie de château. Pendant dix mois, elle allaite, berce et dorlote celui qui deviendra l’illustre Maréchal Leclerc, libérateur de Paris à la tête de la 2ème DB, le 22 août 1944.

A droite, illustration du Maréchal Leclerc.
La nounou de Kermaria donne entière satisfaction à la noble famille. Elle y retournera à quatre reprises, toujours comme nourrice. L’occasion pour elle de découvrir des villes de garnison comme Nancy, Lunéville, Alençon, Saumur et de fréquenter des stations balnéaires à la mode comme Deauville, Dinard, La Baule et les Sables d’Olonne.
Quand Marianne apprit en 1947 la mort du Maréchal Leclerc dans un accident d’avion près de Colomb Béchar, elle pleura toutes les larmes de son corps.
Etonnant destin que celui de cette pauvre paysanne qui a pu mesurer la distance sidérale entre la vie à Fospoul et celle au plus haut rang d’une société aisée.
(Mes remerciements à Marie-Laure Le Merrer, l’arrière-petite-fille de Marianne qui m’a transmis la documentation)
JE ME SOUVIENS DE LA CONSTRUCTION DU FOYER RURAL

Comme dans l’église, selon la tradition, les femmes se sont regroupées ensemble.
Coiffes du Trégor et tenues noires. On est à mille lieues des actuels bals à papa et à papy !
C’est un jour de juillet 1954. La construction du Foyer rural touche à sa fin. Le maire Pierre Bourdellès s’impatiente. Il craint que tout ne soit pas prêt pour le bal inaugural. Il demande à une poignée de jeunes de 10 à 13 ans dont je fais partie de venir donner un coup de main. Un matin, nous embauchons sur le coup de 9 heures. C’est un travail que nous trouvons plus agréable que certains travaux des champs comme le ramassage des pommes de terre. Il consiste à accoler sur la chape de ciment des morceaux de carrelage préalablement cassés à la masse par un ouvrier. Un carreleur passe derrière nous avec une batte pour mettre le tout de niveau. Nous – les jeunes – étions pleins d’application sur la partie surélevée quand, peu avant midi, arrive M. Groleau ou M. Coulombeau – je ne sais plus exactement lequel – . Nous voyant là, il s’écrie : « Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? Les gosses dehors ! » Devant une telle autorité, nous avons pris nos cliques et nos claques sans demander notre compte. Nous avons enfourché nos vélos pour filer à Pont-ar-Stang où ce jour-même passait le Tour de France. Ce soir-là, le coureur Dominique Forlini remportait au sprint l’étape Saint-Brieuc-Brest. Finalement, nous n’étions pas trop mécontents de la tournure des opérations.
JE ME SOUVIENS DE CETTE VEILLÉE DE NOËL 1954…
A l’emplacement de l’immeuble qui fait angle de la rue Saint-Yves vers le Stade municipal ou vers l’école Diwann, il y avait un garage et une allée de boules couverte appartenant au Bar-Restaurant Gouriou.

veillées de Noël, séances de cinéma avant la construction du Foyer Rural.
Jusqu’à 1955, date de la construction du Foyer Rural, ces locaux sommaires servaient à plusieurs usages. Tante Jeanne y entreposait là bouteilles de gaz. Elle y faisait sécher draps et linge de la clientèle hôtelière. On y organisait des bals animés par des orchestres locaux, des banquets, des repas de noces… C’est là que les Louannécain(e)s de ma génération ont vu leurs premières images de cinéma sur écran – plutôt sur un drap blanc tendu au fond la pièce. Les films muets de Charlot (Charlie Chaplin), ceux de Laurel et Hardy étaient très prisés de public…
C’est là aussi que, ce soir de Réveillon 1954, la population de Louannec s’est réunie pour une veillée dans l’attente de la Messe de minuit. Un spectacle, très moyen dans sa présentation, suffisait à satisfaire le public, déjà conquis par l’esprit de la fête. Suzanne Damany, alias Goascabel, présentait des tours avec son chien savant. On revoyait Suzanne dans une ou deux saynètes où son jeu d’actrice déchaînait les rires.
Edouard Ollivro qui a écrit le livre « Picou, fils de son père » n’était pas encore parti à Guingamp où il serait professeur d’Histoire et Géo, puis plus tard Maire de la Ville et député. Edouard présentait ce soir-là un jeu « Quitte ou double » copié sur les jeux radiophoniques de l’époque. Je ne sais comment ni pourquoi je me suis retrouvé sur la scène comme candidat, complètement gagné par le trac d’être devant autant de monde ! Première question qui m’a été posée : Quelles sont les communes qui ont une frontière avec Louannec ? Pour certaines comme Trélévern, Kermaria-Sulard, Brélévénez et Perros-Guirec, ça me semblait évident. Mais il m’en manquait deux : Rospez et Saint-Quay-Perros !
Scratché que j’étais dès la première question ! Le garçonnet de 10 ans que j’étais alors a dû regagner sa place, la tête basse…
JE ME SOUVIENS DE L’INAUGURATION DU CHÂTEAU D’EAU DE MABILIÈS
L’inauguration du château d’eau de Mabiliès, construit à l’emplacement de l’ancienne gare de chemin de fer, a eu lieu en mars 1955. Le hameau ne comptait alors qu’une dizaine de maisons.
Deux enfants du quartier, René Le Garrec et moi-même, avions été désignés pour couper le ruban tricolore et offrir un bouquet de fleurs à René Pléven, ancien Président du Conseil, ce qui sous la Quatrième République équivalait au poste de Premier Ministre.
JE ME SOUVIENS D’AVOIR RAMASSÉ DES CAILLOUX LORS DE L’AMÉNAGEMENT DU STADE MUNICIPAL…

Lors des travaux d’aménagement du stade municipal en 1954, nous, les élèves de l’école primaire avions été sollicités, un jeudi matin, pour ramasser les cailloux qui émergeaient en surface. Nous partions de la ligne de but avec chacun un « baner goat » (un panier en bois utilisé pour le ramassage des pommes de terre) si bien qu’avançant tous au même rythme, nous couvrions toute la surface du terrain. Louis Bourdellès était content. Le travail avançait bien. Jusqu’à ce que l’un d’entre nous suggère que toute peine mérite salaire. Boum, un vent de fronde s’est levé dans nos rangs. La question était de savoir si nous aurions notre repas de midi ou si nous aurions un quelconque pécule en récompense de nos efforts. Pierre Philippe qui n’avait pas froid aux yeux et un autre camarade de classe furent choisis pour aller porter nos revendications en haut lieu. Face au refus qui leur fut opposé, je crois que nous avions quitté le chantier prématurément ! Cette rébellion juvénile ne distendit pas le lien – loin de là – entre les jeunes louannécains et le président du club.
JE ME SOUVIENS QUE NOUS DÉNICHIONS LES OISEAUX…
Quand nous étions jeunes, nous vivions proches de la nature. Presque tous, écoliers de Louannec, étions des enfants de paysans. Presque tous nous gardions les vaches, les clôtures électriques n’étaient pas encore en service. Nous connaissions, par cœur et par leurs noms, les champs, les prés, les bosquets, les ronciers, les haies de troènes, les recoins des ruisseaux …
Garnements que nous étions, notre occupation principale, quand arrivait le printemps, était de nous lancer à la recherche de nids d’oiseaux. Et de nous lancer ce stupide défi : Lequel d’entre nous aura le plus d’oeufs ?
Nous avions notre langage à nous pour décrire un nid trouvé. « Celui-ci est vankède ! » (Vank en breton signifie boue), c’est-à-dire que le couple d’oiseaux était en train d’enduire de boue le sous-bassement du nid fait de brindilles et de pailles… « Celui-ci est doucède ! » c’est-à-dire que le nid, enduit de mousse ou de crin de cheval, est prêt à recevoir la ponte. Poser la main dans un nid comme celui-là pourrait le caser, c’est-à-dire que le couple d’oiseaux se sentant découvert , irait s’installer ailleurs, abandonnant cette construction initiale.
Notre activité qui a fait d’énormes dégâts sur la faune locale, n’était pas mal perçue par les adultes. Ni même par nos instituteurs qui étaient bien au courant de nos activités du jeudi, alors jour chômé pour l’école. Généralement, après avoir vidé chaque œuf de son contenu, en trouant la coquille à chaque bout avec une aiguille, chacun faisait un collier plus ou moins long…
Les victimes de nos folles entreprises étaient surtout les merles, les grives, les geais, les pies, les corbeaux, les poules d’eaux. Les petits passereaux, pinsons, fauvettes, rouges-gorges, roitelets, avaient grâce à nos yeux…
Qu’aurait dit la LPO si cette pratique avait perduré !
Un jour, après l’école, à Cacousiris, Jacky Lamézec (de Cabatous) qui grimpait aux arbres avec l’agilité d’un singe, était monté au sommet d’un peuplier pour dénicher des pies. Il se balançait au sommet de l’arbre, là on le fût est étroit, au risque de se rompre les os. Jamais il n’a pu poser la main dans le nid tant le couple de pies, aidé par quelques autres, a défendu bec et ongles le territoire convoité ! Une scène très proche de celles qu’on a vues dans le film « Les oiseaux » d’Alfred Hitchcock.
Plus dramatique fut l’accident qui est survenu dans une ferme de Louannec. Les pies, les corbeaux, les buses, les éperviers causaient des dégâts sur les basses-cours. Un vol en piqué et l’oiseau repartait avec dans ses griffes un petit poussin jaune ou un caneton sans défense. C’est ce qui se passait au 25 rue du Stivel où vivait la famille Guézennec. Le père dit à son fils Jean qui avait une vingtaine d’années : « Il va falloir dénicher ces pies ! » Jean grimpa à l’arbre. Quand il fut presque au faîte, la maîtresse branche cassa. Le pauvre jeune homme se trouva au sol, mort sur le coup. Cet accident parqua les esprits et toute la population – tout le monde se connaissait alors – prit part au deuil. Yves, le frère du défunt, qui combattait en Algérie, bénéficia d’une permission spéciale pour assister à l’enterrement. « Je ne suis arrivé que le soir des obsèques… » regrette-t-il encore aujourd’hui…
JE ME SOUVIENS : QUAND J’ÉTAIS MITRON
J’apprends qu’un apprenti couvreur n’a pas le droit de monter sur un toit avant l’âge de 18 ans, qu’un apprenti-boulanger n’a pas le droit de porter des sacs de farine de plus de 20 kilos ! Cette règlementation me fait sourire. Mais elle indique tout le cheminement qui a été fait en deux générations pour préserver l’intégrité physique des jeunes… J’ai publié un texte „Quand j’étais vacher“ qui a recueilli écho auprès de nombreuses personnes de ma génération. Elles se sont reconnues au travers de mon récit. Un peu plus tard, j’ai été mitron. Beaucoup de jeunes travaillaient comme moi dans d’autres activités, là où ils trouvaient du boulot. Plusieurs de mes camarades sont entrés en apprentissage direct sur les chantiers à l’âge de 14 ans. Une formation dure et rude. Ce n’était pas la joie ! C’est que nous vivions avec des adultes qui avaient connu la Guerre 14-18 ou qui avaient passé quatre ans captifs dans les stalags en Allemagne. Ils ne nous serait pas venu à l’idée de nous plaindre des conditions de travail imposées, même si elles étaient à mille lieues de ce qui se pratique aujourd’hui. Nous n’en sommes pas morts et nous en gardons un souvenir distancié. Témoignage…
Il faisait beau. Les grandes vacances commençaient… La distribution « solennelle » des Prix avait eu lieu dans la salle des Fêtes de la noble Institution. Je respirais à pleins poumons l’air de Mabiliès. J’étais libre comme le vent. Plus de prières à rabâcher du matin au soir ! Je venais d’avoir 13 ans et je sortais d’une année scolaire sans histoire en classe de cinquième. A peine rentré à la maison, ma sœur aînée Maryannick qui m’avait en charge, me dit : « Il n’est pas possible que tu restes à la maison à te tourner les pouces. Et puis on n’a pas les moyens. J’ai contacté la Pâtisserie Martinet à Perros. René-Yves et toi, vous commencez, lundi à 7 heures… »
François-Marie, un de mes oncles qui habitait à Truzugal, avait eu vent de cette embauche saisonnière bien avant nous. François-Marie était un homme bon, toujours d’humeur égale. Il avait donné les sept meilleures années de sa vie à la Mère Patrie ! Trois années de service militaire à Guingamp et quatre années dans un club de loisirs appelé « stalag » en Allemagne. A l’invitation du Fuhrer ! Il n’en parlait jamais. François-Marie avait anticipé son aide aux futurs mitrons. Il avait apporté deux vélos « demi-course » qui avaient appartenu à son fils Pierre, à Pont-Couennec. Louis Le Montréer, le mécanicien, avait remis tout ça en état : freins revisés, pneus neufs. Et roule ma poule ! Dans sa générosité et dans la pitié qu’il avait à notre égard, notre oncle avait ajouté : « Il vaudrait mieux que veniez tous les deux manger ici à midi. Ca vous évitera le trajet de Mabiliès et cette dure côte du Bourg. » Connaissant le goût du pâté de lapin et celui des crêpes que préparait Tante Augustine, mon frère et moi nous avons topé sans aucune hésitation…
Le lundi matin, à l’heure dite, mon frère et moi étions sur place, à l’embauche, rue du Maréchal Leclerc, curieux de découvrir un monde nouveau. Nous sommes entrés dans un long couloir. Nous avons accroché notre veste à une patère. Nous avons débouché dans une arrière-cour couverte. Une bonne odeur de grillé nous chatouilla les narines. A gauche, tout un empilement d’ustensiles en attente d’être lavés. Sur un côté, des volumes frigorifiques contenant beurre, margarine, lait, œufs, fruits confits…Sur le dessus, des postes de travail. Occupant une grande partie de l’espace, le « laboratoire », c’est ainsi qu’on appelait le fournil. Un homme à grosse moustache noire, veste blanche de chef cuisinier, enfournait des plaques de croissants. Il nous toisa tout en continuant sa besogne. Comme il sortait du four des croissants tout chauds, il me demanda : « Tu veux en manger un ! – Non, lui ai-je répondu, comme pour indiquer que j’étais venu là pour travailler et non pour prendre mon petit-déjeuner !».
L’homme à la grosse moustache, c’était le patron. C’était Henri Martinet. Il chantait souvent et plutôt bien. Il plaçait avec dextérité dans le four les plaques qu’il tenait en équilibre sur sa pelle en bois. Il m’avait baptisé « Napo » étant donné que j’avais une mèche devant, sur le front. Comme Bonaparte au Pont d’Arcole…
Son second était Jean-Pierre Mével. Un brave garçon ! Comme il était en début de carrière, il se sentait assez proche de nous, les marmitons. Et complice ! Jean-Pierre nous a quittés pour toujours, il y a quelques années. Ses amis du club de pétanque au Linkin m’ont dit : On l’appelait « Tino » tellement il chantait bien. Tino, vous aurez fait le lien avec Rossi. Un jour, il ouvrit son portefeuille et il me demanda en me montrant une photo : « Tu ne trouves pas que ma femme est plus belle que celle du patron ? » La femme de Jean-Pierre était une belle brune ; la femme du patron était une belle blonde… Comme je tenais à rester en bons termes avec Jean-Pierre, j’ai penché pour la brune, mais sans trop de conviction…
Un intermittent de la pâtisserie venait prêter main forte les jours de coups de grande affluence. Le 15 août, par exemple, journée marquée d’une pierre blanche. Ces jours-là Bébert venait faire des extras. Du black en complément de son poste de cuisinier-chef au Centre Héliomarin de Trestel…
La quatrième adulte était Anne, un beau brin de jeune fille. Elle travaillait à la mise en boîte des galettes et à l’ensachement des madeleines. Le soir, pour se faire un complément de salaire, elle était placeuse au Cinéma Le Celtic…
Pour assister cette équipe de « pros », il y avait une escouade quatre ou cinq mitrons. Il y avait Jean-Pierre Le Corre. Un jeune de Louannec, comme nous. Jean-Pierre était encore moins épais que nous. Le patron l’avait surnommé « Globulos ». Il y avait un certain Favé. Quand j’ai vu la belle maison de ses parents à La Châtaigneraie, je me suis demandé ce qu’il faisait là. Il y avait enfin mon frère René-Yves et moi…
Ce jour d’embauche, M. Martinet me conseilla de revêtir un tablier blanc et de me mettre à la table en duo avec lui. Le travail du mitron consistait à déposer les croissants chauds sur une grille qui, une fois remplie, prenait le chemin du magasin où officiait Mme Martinet. Ensuite, on passait aux galettes. Puis aux madeleines. Une approche plus délicate : « Prends-les par les nichons. Sans serrer trop fort, conseillait le « boss » en guettant du coin de l’œil si je souriais à sa plaisanterie. Pour les madeleines, pas de temps à perdre car les moules devaient être enduits de cire sur le champ pour une nouvelle fournée. Au début, je trouvais que ça faisait chaud aux doigts. Grâce à cet entraînement quotidien, je supporte aujourd’hui sans mal les plats brûlants, les jours de barbecue, à la surprise de mes amis…
Quand je n’étais pas à la table, près du four, on me confiait d’autres tâches. Faire la vaisselle, ce qui était tout un chantier. Une montagne de casseroles en cuivre de toutes tailles, des plats enduits de crème, des pelles en bois, etc… Les mitrons ne se battaient pas pour assurer ce travail ingrat. Souvent, il fallait casser des œufs. On disait 10 litres ou 20 litres. C’est-à-dire qu’on cassait des œufs jusqu’à atteindre ce volume ! Des œufs que l’on mettait dans le pétrin pour le mélanger avec la farine et le sucre. Une autre fois, c’était couper les éclairs que garnissait ensuite un pâtissier avec sa poche de crème… Que sais-je encore ?
La livraison prenait place dans l’emploi du temps. Le vendredi, jour du marché, j’approvisionnais M. Samson, de Pont-Couennec, qui avait son étal. Je trouvais à cet homme un faux air de Caïfa, celui qui venait vendre du café vert à la maison à Mabiliès…Je partais à pied, longeais le mur du presbytère et l’Eglise Saint-Jacques. La charge était assez lourde !
Le week-end, c’était livraison aux hôtels et aux particuliers. Le plus souvent à vélo. Un jour, je suis arrivé avec ma boîte de carton contenant un Paris-Brest dans une grande propriété. D’un côté on plongeait sur la plage de Trestraou, de l’autre sur celle de Trestrignel. J’ai sonné. Arriva une femme toute couverte de bijoux autant que la Bégum, l’épouse de l’Aga Khan ! « Ah, qu’il est mignon ! Quel gentil petit garçon ! etc.., etc… » La douairière se rendit vers une armoire, l’ouvrit et sortit un pourboire. Tout bonus ! pensais-je. Jackpot ! Walou, la richissime mangeuse de gâteaux ne me glissa dans la main qu’une modestre pièce de 5 centimes en fer blanc…
Une autre fois, cap sur Louannec. Le Foyer Rural était à ses premières années d’existence. Il s’agissait de livrer une pièce montée à la fin du repas d’un mariage. Bébert était au volant de la voiture. Moi à ses côtés je tenais le précieux fardeau sur mes genoux. Je me disais : « Si au moins Tonton François-Marie est au bord de la route à Truzugal quand on passera… Il serait fier de moi !… » Opération accomplie. « Vous prendrez bien un verre ? demanda une cuisinière. Bébert annonça la couleur : Oui, je veux bien un cognac. Et toi, jeune homme ? je répondis du tac au tac : Pareil ! Surprise de la femme : Te, ma faotr bihan, ma ec’h eus prenved, int da vont en traon… ! »( = Toi, mon petit, si tu as des vers, c’en est fini pour eux !)
Une autre fois, M. Martinet avait reçu un fût de Bordeaux qu’il fallait mettre en bouteilles. Comme j’avais vu faire chez L’Hévéder-Le Corre à la Rade, je me suis porté candidat pour un travail à assurer de A à Z : lavage et rinçage des bouteilles, embouteillage, mise en place des bouchons et collage des étiquettes ! J’avais rempli les bouteilles à l’aide d’un long tube en caoutchouc. Il se trouvait qu’un certain nombre d’entre elles étaient trop pleines pour accepter le bouchon de liège. Pas de problème, me dis-je, je vais absorber le trop plein. Un centimètre cube par ci, un centimètre cube par là… Ce soir-là, je descendi la côte du Bourg de Perros à tombeau ouvert. Comme Picou quand il dévalait le Mur de la Mort sous le regard inquiet de son ami Floch…
Ce matin-là fut dur pour moi. Très dur ! Louannec-Sports au complet allait passer la journée à Jersey. Le nombre de places était limité, le déplacement se faisant par avion départ de Servel. Louis Bourdellès s’était excusé auprès de moi, m’assurant que s’il y avait eu une place de plus, elle m’aurait été attribuée. Vers 6h30 du matin, alors que j‘ allais à vélo à Perros, je vis mes amis endimanchés, regroupés sur la place du Bourg. Je suis passé devant mes amis, droit comme un « i ». Je n’ai jeté jeta aucun regard vers qui que ce soit. Mais, une fois seul, dans la descente, je me suis mis à pleurer à chaudes larmes. Un flot de larmes qui ne cessa qu’à hauteur de Pont-Couennec au moins. Ce matin-là, M. Martinet avait chanté sans doute « Le facteur de Santa Cruz » ou quelque chose d’aussi amusant. Ce qu’il faisait chaque fois qu’il se rendait compte que le moral de son petit commis était en berne…
Cet autre jour fut mémorable. Le patron s’était absenté pour des raisons qu’il ne nous avait pas dites : démarches administratives, présence à des obsèques ? On ne sait trop…Le chat parti, les souris dansent, dit-on. Et ce fut le cas. Le tout orchestré par notre maître à penser Jean-Pierre. Devant le four, la pelle en bois tenue comme un fusil, il chantait : Hello, le soleil brille, brille, brille. Le tube du moment que l’on avait découvert comme musique du film « Le Pont de la rivière Kwaï » Dien Bien Phu, ce n’était pas vieux ! … Dans le labo, ça volait bas : sauce, crème, morceaux de gâteaux. Et ça piaillait comme dans une basse-cour ! Comme une soirée au Club Med au plus fort de l’animation. Il ne nous manquait que les cotillons et les serpentins ! Nous aurions dû être plus prévoyants car M. Martinet était coutumier du fait. Il simulait souvent un départ. Quelques minutes après, il revenait faisant semblant d’avoir oublié quelque chose. Là, nous étions pris en plein flagrant délit, je dirais même la main dans le sac ! Trop tard pour réparer les dégâts. Tel un spéléologue en train de franchir un boyau, un des gâte-sauces n’avait que les pieds qui sortaient du frigo. Il s’empiffrait d’oreillons de pêche et de crème fouettée. « Qu’est-ce que tu fais là ? lui demanda le patron… Mais le plus dur était à venir… Une fumée noire et âcre se répandit dans la pièce quand Jean-Pierre ouvrit la porte du four. Jean-Pierre, celui qui avait une belle femme brune, pris par l’ambiance, le chahut et le feu de l’action – c’est le cas de le dire – n’avait pas entendu sonner le top de la minuterie. Toute la fournée passa à la poubelle. Nous avons travaillé jusqu’au soir dans le plus grand des silences, penauds, comme pour expier nos fautes et notre insouciance !
Quelques années plus tard plus tard, je n’étais plus vacher, je n’étais plus mitron, je me promenais près de la Plomée à Guingamp…Je vis qu’une grande pâtisserie, sur cette place, portait le nom Martinet. Pas de doute, ça ne pouvait être que lui ! Je suis entré pour revoir M. Martinet dont je gardais un bon souvenir. En revanche, je ne me suis pas fait d’un prêtre qui, tel le chien de Pavlov, salivait devant une vitrine choux à la crème et mille-feuilles. C’était le Chanoine L.C.. Et pourtant, je ne gardais pas un mauvais souvenir de cet homme qui avait été mon professeur de français et de latin en seconde…
Ce récit est anecdotique mais vrai. On peut toutefois, sans lancer la pierre à qui que ce soit, placer la réflexion sur les « anomalies » et les conditions de travail en ce temps-là. Cet emploi saisonnier n’était couvert par aucun contrat, ni de travail ni d’assurances ! Serait-il arrivé un accident dans ce laboratoire? on aurait dit : C’est la fatalité ! Point barre… Oserait-on imaginer aujourd’hui ce que faisait un enfant de 13 ans : 70 heures de travail par semaine, aucun jour de congé pendant deux mois, même pas le dimanche ! Et puis, pour couronner le tout, un salaire à hauteur de 5 francs par jour. Avec 5 francs, en 1957, on pouvait acheter soit 3 baguettes de pain soit 500 grammes de beurre soit 20 œufs soit 2 places de cinéma. C’était comme ça ! J’ai néanmoins bien vécu cette expérience puisque l’année suivante j’y suis retourné… Dire : C’était mieux avant, n’est pas forcément vrai….
JE ME SOUVIENS DES TRAVAUX À LA FERME…
1 – « SEMER LES PATATES» ET « TIRER LES PATATES » !
Le travail autour de la pomme de terre mobilisait beaucoup de monde à la ferme. La traduction littérale du breton nous faisait dire « semer les patates » et « tirer les patates » alors qu’il aurait fallu dire « planter les pommes de terre » et « arracher les pommes de terre » !
Quand une parcelle avait été retournée à la charrue, passée à la herse et au brise-mottes, le cultivateur creusait des sillons avec la houe, sillons qui accueilleraient les plants disposés l’un de l’autre d’une trentaine de centimètres. Conduire le cheval dans les petites parcelles n’était pas très facile. C’était agréable en ligne droite, la main droite pratiquement sur le mors près du doux naseau de la jument et de ses grosses dents jaunes. C’est quand il fallait tourner que ça se compliquait tant je craignais que l’animal ne me piétine avec son sabot ferré !
Auparavant, les plants de pommes de terre avaient séjourné dans un grenier, souvent au-dessus de l’étable, la chaleur ambiante facilitant la germination. Les plants étaient disposés les uns contre les autres, debout dans des caisses plates en bois. Les plus gros plants étaient coupés en deux…
Le jour J, au cours du mois de février, chacun prenait caisse après caisse et disposait les plants dans le sillon. Un travail fastidieux quand soufflait un vent froid quelquefois accompagné de grêle. Pas question d’abdiquer ! Un adulte recouvrait le tout avec un croc.
A la mi-mai, pour les « primes », commençait l’arrachage avec un croc. J’avais été surpris quand, une fois que j’avais été invité chez un ami à Lohuec, j’ai vu faire ce travail à la bêche ! Louannec, commune côtière, a la chance de posséder des parcelles pratiquement préservées du gel, l’ennemi n°1 de la pomme de terre. La vente de ces premières pommes de terre de l’année était plutôt d’un bon rapport. Sauf les années où la production était plus forte que la demande et où les cultivateurs en guise de protestation balançaient le long des routes des patates sur lesquelles ils déversaient du gas-oil…
Deux mois plus tard, on s’attaquait aux pommes de terre de « conservation », celles qui nourriraient la famille de toute l’année. Dans un premier temps, le ramasseur mettait les tubercules en rangée séparées par les fanes qui avaient été délestées de leur contenu. L’après-midi, le tout était trié : les patates qui avaient pris la lumière et qui étaient vertes seraient destinés à faire des plants ; les petites les mal formées seraient cuites pour les cochons et les « bonnes » conservées pour la consommation de la ferme.
2 – FAIRE LA MOISSON…
Dans les années 50, les ouvriers agricoles débroussaillaient les talus dans un premier temps. Ensuite ils coupaient le blé à la faux sur la partie extérieure de façon à laisser de la place pour la moissonneuse-lieuse tirée par un cheval. La machine faisait des gerbes relativement légères puisque même nous les enfants pouvions les disposer en javelles qui ressemblaient à des tentes indiennes. En fin de journée, on s’offrait même des parties de cache-cache dans ces « tipis » improvisés. Les gerbes restaient quelque temps sur la parcelle pour terminer son séchage.
Ensuite avait lieu le charroi vers la ferme. Quand la haute charretée était faite, on la retenait en tendant de solides cordes, des « tortisses » disait-on. Ces gerbes étaient enfin disposées à la ferme sur l’aire en attendant le jour du battage…
3 – FAIRE LES FOINS…
La fenaison était aussi un moment important de l’année. Tellement important que les règlements officiels scolaires autorisaient les enfants des fermes à vaquer un certain nombre de jours pour prêter main forte à leurs parents. Les hautes herbes vertes étaient coupées par la lame de la faucheuse. Cette herbe était ensuite aérée soit à la faneuse soit à la fourche pour sécher. Une fois sec, le foin était charroyé et entasser dans la grange pour servir de fourrage d’hiver pour le bétail…
4 – PLANTER BETTERAVES, NAVETS, CHOUX..
Une fois la terre passée au rouleau, on traçait des rangées avec une sorte de grand râteau en bois. L’ouvrier faisait des trous à l’aide d’une petite bêche à forme triangulaire et nous les enfants nous suivions. Nous avions sous le bras gauche, une cinquantaine de plants que nous avions au préalable passé dans un seau de boue. Puis nous suivions l’adulte mettant les plants un par un dans les trous que nous bouchions du pied droit. Quand la terre était un peu humide, c’était facile. Quand la terre était sèche, le petit cratère s’écroulait et il était plus difficile d’y glisser le plant…
5 – ARRACHER LES BETTERAVES…
J’aimais beaucoup ce travail qui coïncidait souvent avec les vacances de la Toussaint. On arrachait la betterave, on la tournait pour enlever les feuilles qui resteraient à même le sol. Ensuite, on chargeait les betteraves dans une charrette et on en faisait à la ferme un tas que l’on recouvrait de fougères.
J’aimais aussi passer les betteraves dans le hachoir électrique et présenter aux vaches les tranches gorgées de liquide dont elles se régalaient…
6 – RETOURNER LE LIN…
C’était le travail le plus « cool ». Le lin avait été disposé sur un pré en andains. Muni d’une sorte de perche de trois mètres environ, on devait passer ce bâton sous la couche de lin pour exposer au soleil et à la pluie l’autre face de la plante. Au bout d’une journée, la petite perche sous l’effet de l’huile que contient la graine de lin, devenait toute lisse.
7 – RAMASSER LES OEUFS…
C’était le ramassage des œufs. Mais à la mode ancienne puisque cette période remonte à 60 ans ! Je faisais la tournée des poulaillers trois fois par jour : une première fois vers 10 heures le matin, puis vers 14 heures et le soir vers 18 heures. Ces horaires ne venaient pas percuter les créneaux dévolus au suivi des vaches laitières : les conduire ou les chercher au champ, les traire, refaire les litières…
Comment procédait-on alors pour collecter les œufs ? On partait avec deux grands paniers à anse en osier. Et il n’y avait qu’à suivre le cours des longs pondoirs occupés par des poules qui venaient de pondre ou étaient sur le point de le faire. Plus gênantes étaient les poules qui souhaitaient couver (« sklokerez » en breton ) et se mettaient en position de le faire. Celles-là étaient belliqueuses et toujours sur la défensive ! Pour éviter les coups de bec, je m’étais élaboré une tactique. Je présentais la main gauche à distance respectable pour ne pas être piqué. Retenant ainsi son attention, je glissais rapidement la main droite sous elle et j’extirpais les oeufs qu’elle aurait aimé garder sous elle. Et le tour était joué… Il est bien connu que la poule est un des volatiles les plus stupides de la création. Les spécialistes de la psychologie animale citent ce test : placez un bol de grain ou des vers de terre derrière un grillage, la poule n’aura pas idée de contourner l’obstacle pour arriver à sa proie…
Des anomalies au cours du ramassage, il y en avait… De temps à autre, on trouvait des œufs sans coquille. N’ayant que la peau que l’on sait, ils étaient tout flasques. Ceux-ci émanaient des poules carencées en calcaire. Pourtant, on les alimentait en coquilles d’huîtres pilées et en sable de mer, du maërl… On ramassait aussi des œufs de taille anormale. Certains très gros contenaient deux ou trois jaunes ; certains très petits, comme des œufs de pigeons, signalaient la fin de la période de la pondaison. C’était courant qu’un œuf vous tombe dans la main tout chaud et tout humide. En direct…
Au fur et à mesure que les œufs étaient rangés dans le panier, ils étaient comptés. Le soir, on établissait le pourcentage de production : le nombre d’oeufs produits en rapport avec le nombre total de poules.
Ensuite, Louis Bourdellès conditionnait dans son « cagibis » les œufs. Il les plaçait dans des alvéoles cartonnées. Après avoir nettoyé avec une solution d’eau vinaigrée ceux qui présentaient quelques souillures. Il chargeait ensuite le tout dans sa 2CV dont il avait pris soin d’enlever le siège arrière et allait faire la distribution à sa clientèle : restaurants, alimentations, cantines, etc… Ces années-là, il n’y avait aucune grande surface dans le secteur. Jean-Jacques Crocq accompagnait Louis quelquefois dans ces livraisons sur la Côte de Granit…
8 – « VIDER » LES POULAILLERS, QUELLE CORVÉE !
Enlever les fientes ou le fumier dans un poulailler pour préparer l’arrivée de milliers de poussins, c’était sans doute la tâche la plus désagréable. On entassait ce fumier infesté de puces dans des charrettes. On enduisait nos bottes d’huile pour réduire le nombre de ces puces qui viendraient nous importuner… Les rats faisaient bon ménage avec les poules. La nuit, ils se lovaient au milieu d’elles en pleine chaleur et le reste du temps ils se gavaient de l’aliment destiné à la volaille. Ramasser les cadavres de rats par mannes entières en période de dératisation n’était pas agréable non plus. Auparavant, nous avions « ramassé » les poulets que nous avions enfermé dans de grandes caisses à claire-voie, caisses qu’un camionneur venaient chercher à destination d’un abattoir…
JE ME SOUVIENS DE VICTOIRE…
Vous connaissez le Restaurant « L’Abricotier » en face du camping Ernest Renan, à Truzugal. Quand j’étais enfant et que je venais à la ferme de mon oncle François-Marie, juste à côté, je voyais vaquer là un couple assez atypique. Marie Esquenet, mémoire du quartier, a connu d’assez près ces deux personnages. Elle raconte :
« François L.C. était originaire de Plougasnou (29). Il avait fait carrière dans la marine marchande. D’un de ses voyages au Brésil, il avait ramené un perroquet. Il y avait deux perroquets dans le quartier à ce moment-là. François avait rapporté un coffre en bois de camphrier qui appartient aujourd’hui à une de mes amies. François était un homme discret, toujours disponible pour rendre service. A son retour sur le plancher des vaches, il s’était reconverti en serrurier et en ramoneur. François L.C., le marin, changea d’identité puisque tous les gens de la commune l’appelèrent Jean-Marie Fourneau. C’est en effet dans le petit bâtiment, à gauche en entrant, que Jean-Marie passait ses journées à réparer quoi ? Des fourneaux, bien sûr…

où Jean-Marie réparait les fourneaux.
Sa femme, Victoire, née D., était issue d’une famille plutôt aisée. Propriétaire d’une partie de la lande du Ranolien, à Perros-Guirec. Victoire était très originale. Elle voulait se donner un genre et impressionner le monde en jouant à la magicienne ! Elle aimait rôder le soir avec un feutre noir sur les yeux. Une nuit, elle avait semé le trouble chez des amis qui avaient planté leur tente près d’ici. C’était bien sûr longtemps avant la création du camping municipal. Certains soirs, elle allait sur le Kinn jouer à la naufrageuse en brandissant une lampe à pétrole… Un jour, je devais avoir 10 ans, j’étais allée chez elle pour vendre des timbres au bénéfice de l’école. Je l’ai trouvée en pleine séance de magie noire ! Elle avait rabaissé son chapeau sur ses yeux, elle avait un chat noir sur une épaule et elle lisait dans son marc de café. Ensuite, elle m’a demandé : Est-ce que tu es allée quelquefois à Placenn ar Grough ? (J’ai vu que, dans ton étude sur Louannec, tu parles de cet endroit où le Seigneur de Barac’h pendait les manants qui s’étaient mis à la faute, selon lui.) Donc elle me dit : Tu devrais aller à Placenn ar Grough. Moi, quand j’y suis, j’ai de bonnes vibrations…
Un jour du printemps 1976, alors que je venais d’emménager à deux pas de chez Victoire, j’ai vu par la fenêtre la pauvre femme, morte sur son lit. J’ai aussitôt alerté la mairie qui a lancé la procédure en usage…
JE ME SOUVIENS D’UNE ERREUR DE JEUNESSE !
Grosso modo, Louannec est une commune qui s’inscrit dans un carré de 4 kilomètres de côté, soit une superficie 6 fois et demie plus grande que la Principauté de Monaco ! Comme la commune a une façade maritime sur toute sa partie nord, on aurait pu s’attendre à rencontrer beaucoup de familles de pêcheurs. Ce n’est pas le cas car le Louannécain était tourné vers la terre comme s’il se méfiait de cette force naturelle et imprévisible, capable de lui jouer des tours… Si on remonte un peu le temps, on trouve du côté du Lenn, une famille composée des deux frères Daniel – Jean et Eugène – aussi forts à traquer le poisson qu’à vider des litres de Santa Rosa, « l’ami de l’estomac ». Une fois la pêche faite, ils montaient à pied vers le Bourg poussant leur carriole, passant à l’acte 2 de leur job : la vente. Eugène Nédellec, 83 ans, s’en souvient : « Quelquefois, il leur fallait prendre un peu de repos et de forces avant d’attaquer la côte du Bourg. Je les ai vus, allongés à l’entrée du Coat Pin… » Leurs rêves les avaient transportés dans le paradis de Bacchus plutôt que dans l’étude des basses théories du profit et du commerce.
Pendant que nos amis prenaient le frais à l’ombre, les maquereaux marinaient au soleil. C’était tout bonus pour les ménagères qui n’auraient plus, pour régaler toute la maisonnée, qu’à faire un aller-retour aux maquereaux et aux lisettes dans la poêle grésillant de beurre. Et puis, le charbonnier ne passait qu’une fois par mois avec sa calèche, tirée par un cheval…
Cette famille Daniel avait l’amour de la mer tellement chevillé au corps que leur mère avait construit sa demeure : une maison en bois, sur le Kinn. Elle avait anticipé sur ce mode de construction qui a fait florès bien plus tard suivant des modèles importés du Cercle polaire et de chez les Inuits. Ils avaient renoncé à construire des igloos, craignant l’arrivée prochaine du réchauffement climatique. J’ai lu quelque part que la « maman » de ces deux pêcheurs voyait souvent passer devant chez elle Ernest Renan, le vacancier de Rosmapamon. Comme celui-ci était toujours plongé dans ses réflexions philosophiques et existentielles, se demandant toujours si Jésus était un dieu ou un homme. Il avait opté pour la solution 2. Résultat : il ne pouvait plus poser le pied à Tréguier, sa ville natale. Et il était heureux d’avoir trouvé refuge à Rosmapamon, à Louannec, au milieu de gens qui ne s’embarrassaient pas d’un problème métaphysique concernant la nature exacte de l’origine du Christ : divine ou humaine. Leurs préoccupations se tournaient vers la réussite des récoltes, la crainte du gel, la survie des gorets et la santé des bovins. L’écrivain-philosophe-historien à la lourde démarche n’adressait que très rarement la parole à celle qui s’était annexé une partie du domaine maritime sur le Kinn, sans se référer à qui que ce soit pour solliciter une quelconque autorisation ou permis de construire. Le maire de l’époque préféra fermer les yeux pour ne pas faire naître un conflit qui pourrait lui donner une image d’homme rigide et hypothéquer ses chances aux futures élections…
Même si ça me procure 65 ans après un sentiment de honte, je dois vous avouer un épisode qui m’a valu une tournée de martinet. A cause des deux Dalton ou à cause de ma bêtise, je n’en sais trop rien. Un soir de printemps, alors que la nuit était tombée, une forte odeur de poisson un peu faisandé vint chatouiller nos narines. Les Daniel arrivaient chez moi, à Mabiliès où mes parents tenaient un débit de boissons. Les deux frangins semblaient aussi assoiffés que les concurrents de la course Paris- Dakar à l’arrivée d’une étape sous le cagnard. Ma mère devait être contente car la présence de ces deux « outres » allait lui permettre d’arrondir le maigre budget de la journée. A moins qu’elle n’ait d’emblée conclu un troc : maquereaux contre pinard !
Alors que les deux bons clients repartaient vers Kermaria – la direction inverse de Truzugal – mon frère et moi avions pensé que les deux hommes allaient prendre un ou deux « derniers coups pour la route » au café Le Garrec, 400 mètres plus loin. C’est là que j’ai commis une irréparable bêtise que je ne m’explique pas encore aujourd’hui. Que peut-il se passer dans la tête d’un enfant de 6 ou 7 ans ? Alors que les hommes de la mer ondoyaient sur la route, cap à l’est, comme s’ils étaient balancés par une forte houle, je les ai suivis dans le champ de l’autre côté du talus. Et écoutez-moi bien, je leur ai balancé des pierres. Ils sont revenus fissa chez mes parents prétextant des blessures à la tête et affirmant qu’ils ne porteraient pas plainte si mon père faisait un petit geste de compensation. Après de longues négociations, il fut convenu qu’une bouteille de vin amélioré, de marque « Pelure d’oignon » équivaudrait à un accord de paix ! Ils quittèrent les lieux en me lançant un regard presque reconnaissant et ils posèrent la bouteille parmi les maquereaux qui avaient tourné l’œil depuis longtemps. Ils partirent rassurés, avec de quoi se ravitailler au moins jusqu’au bourg. Jusque chez Tante Jeanne…
Il y avait un autre pêcheur qui vivait à Kermaria, un costaud venu de Douarnenez. C’est à Douarnenez qu’ont eu lieu les premières révoltes ouvrières menées par les femmes qui mettaient les sardines en boîte. Dans ce fief gagné aux idées de la CGT et exploité par le capital, on votait « coco » à fond la caisse ! Marcel Pouliquen, c’était son nom, ne se trompait pas de bulletin de vote, le jour des élections. Quand il croisait Pierre Bourdellès – qui connaissait les idées révolutionnaires du néo-Kermarianais -, Marcel, enhardi par le liquide ingurgité dans l’après-midi, disait : « Pipi, la prochaine fois, je prendrai ton fauteuil ! » Marcel ne plaisantait pas. Il ne parlait pas du fauteuil dont il aurait eu besoin sur-le-champ pour cacher son équilibre chancelant mais du fauteuil de député. Marcel n’a jamais eu l’investiture du parti à l’effigie de la faucille et du marteau. Les caciques du Parti communiste avaient préféré miser sur Jean Le Lagadec, de Plufur, rédacteur-en-chef de « L’Humanité » qui, à l’époque, rivalisait question ventes avec les autres titres de la Presse nationale.
Ceci étant, un assez grand nombre de Louannécains s’en allaient sur les flots, engagés dans la « Royale » ou marine d’Etat. Ou encore dans la marine de commerce avant que la Compagnie Delmas ne soit dépecée au profit de pavillons de complaisance, laissant sur le sable nos vaillants et compétents marins…

par l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées Harel de la Noë.
Une quinzaine d’embarcations fréquentaient ce petit port, protégé par le cordon du Kinn. Les bateaux y accostaient pour décharger sable, maërl et goémon à destination des cultivateurs de la région. Toujours une activité tournée vers le monde agricole…
JE ME SOUVIENS DU CONSEIL DE RÉVISION PASSÉ EN 1962…
Je relève ce passage dans l’excellent livre d’Edouard Bled -vous avez sans doute connu ses exercices d’orthographe!- , livre au tire : « J’avais un an en 1900 ». « Je passai le conseil de révision en janvier 1918, à la mairie du IVème arrondissement. Je retrouvai tous mes copains d’école. Nous nous étions quittés en sarrau noir et nous nous pressions tout nus à la queue leu leu. Cela nous faisait un petit quelque chose. Devant moi et derrière moi, un conscrit tout petit. Entre eux, j’avais l’air d’une fameuse asperge. On me toise : 1,77 m. On me pèse : 80 kg. On m’enfonce un doigt dans le bas-ventre pour s’assurer que je n’ai pas de hernies. J’ouvre la bouche. On veut voir mes dents comme au temps où l’on déchirait les cartouches. Un simulacre d’auscultation et le major à trois galons qui est assis me demande, comme le ferait un douanier : « Rien de spécial à déclarer ? » Je suis bon pour le service armé… »
Oui, tous les ans, les jeunes du canton, âgés de 18 ans, étaient convoqués à la Mairie de Perros pour une drôle de mascarade. Nus comme des vers, les conscrits passaient devant une commission comprenant un médecin-major de l’armée, des infirmiers, des représentants de la gendarmerie, tous les maires du canton. J’en oublie peut-être… Les conscrits étaient pesés, mesurés sous la toise, palpés et, à l’issue de la journée, tombait le verdict : bon pour le service ou inapte pour le service militaire. Ceux qui étaient réformés pour une infirmité invalidante, pour être trop légers ou pour avoir les pieds plats, vivaient assez mal cette exclusion…
A la sortie de la Mairie, les marchands du temple étaient là. Ils vendaient à prix d’or des breloques, des colifichets avec inscrit dessus : Bon pour le service, Bon pour les femmes ! , des cocardes tricolores.
Le chemin du retour à Louannec était semé d’embûches car chacun voulait offrir à boire à ces futurs vaillants soldats appelés à défendre la Mère Patrie.
Quelques mois plus tard, les conscrits aptes étaient convoqués à la caserne de Guingamp, centre de sélection de tout le Grand Ouest de la France pour subir des tests plus approfondis : niveau scolaire, aptitudes en vue d’une prochaine incorporation dans telle ou telle arme : terre, mer ou air…
Nous n’étions que trois de Louannec à être nés en 1944 : Michel Darrort, Hervé Goasampis et moi…
Ceux qui sont passés l’année précédente (photo ci-dessus) ont échappé de peu à la Guerre d’Algérie. Ils ont passé le Conseil de révision en 1961 et les accords d’Evian qui mettaient fin au conflit, a été signé le 18 mars 1962 !
JE ME SOUVIENS D’UNE CORRIDA LE LONG DU LENN
Je ne sais pas quelle mouche m’a piqué, ce jour de 1976, quand je me suis mis en tête d’acheter un veau sur pied à la ferme. L’envie de perpétuer les coutumes d’autrefois, peut-être… Un « veau de lait » ? Mon œil… Si j’avais été un bon maquignon, j’aurais remarqué que le regard de l’animal se faisait plus vif et clignotait davantage au vu de la croupe engageante d’une génisse qu’au vu du pis de sa mère, même dégoulinant de lait crémeux ! Ce veau, c’était déjà un « jeune homme », plein d’ardeur et de force…
De force, c’est sûr, car au moment où mon ami Dédé – le bourreau – a voulu lui porter le coup fatal entre les deux yeux, le veau s’est délié de ses entraves. Il nous a dit : Ciao… et il a pris la clef des champs. Et pas que ça, vous allez voir… Le veau a déboulé sur l’axe Perros / Tréguier, au niveau du Camping, sans se soucier des contraintes du Code de la Route, à l’heure où la circulation était la plus dense. Retour des plages, de Trestraou et de Trestrignel. Dédé et moi, nous nous sommes lancés, comme un seul homme, à la poursuite du fuyard. Je pensais, inquiet : Accident ? Responsabilité civile ? Tribunal, et tout le tralala… Un témoin de la scène nous voyant en difficulté, alerta Christian Crombez, au Camping. L’ami Christian ne fit ni une ni deux : solidarité avant tout… Il déclencha le plan ORSEC et décréta la MOBILISATION GÉNÉRALE. Il ferma provisoirement son bar du camping. Il convainquit les quelques clients qui s’ennuyaient devant leur Kronenbourg de venir faire œuvre utile. Nous étions bientôt une vingtaine à mener la chasse et à traquer la bête… Les automobilistes, ébahis, se croyaient aux fêtes de Bayonne. Sauf qu’à Bayonne, les humains courent devant. Nous, on était derrière…
Arrivés à la hauteur de Pen-ar-Garenn, là où se trouve aujourd’hui un Motel, le veau, évalua la situation et se dit : « Changeons de tactique. Maintenant qu’ils savent que je cours vite, je vais leur montrer une autre facette de mon talent… » Et plouf … Plongeon dans le Lenn !
Aucun d’entre nous ne pensa à suivre l’émule de Florent Manaudou. Pourtant l’eau n’était pas froide. Là où il était, il ne causerait aucun danger à autrui, si ce n’est semer la panique dans un banc de mulets, peu habitués à faire une telle rencontre dans les eaux calmes du bassin… Du bord, on appréciait la brasse coulée du taurillon. On le vit sur le Kinn faire feu des quatre fers, soulevant des nuages de sable, dérangeant et faisant fuir une douzaine de bernaches cravants en plein repas. Il s’engouffra, à la vitesse de l’éclair, les naseaux frémissants, dans les herbes de la pampa et entre les saules, ivre d’une liberté retrouvée…
Acte 3… Le veau revint vers nous à la nage et nous nargua une fois de plus, nous jouant un nouveau tour, tout aussi pendable. En deux temps trois mouvements, il se retrouva, après avoir escaladé un talus très abrupt, sur le plateau de Kernu. Là-haut, mort de fatigue, il rendit les armes, l’oeil triste et globuleux. Avec les honneurs… Un sentiment de pitié me traversa. Compte tenu de ses performances d’un très haut niveau, j’eus presque envie d’user de mon droit de grâce. Mais où parquer un aussi encombrant pensionnaire ?
Il était écrit de ce veau, adepte du triathlon, que j’aurais sa peau, mais que lui aussi aurait la mienne… Une fois la bête dépecée, nous avions disposé les morceaux de viande sur un drap blanc dans le sous-sol de ma maison, le temps que la marchandise s’attendrisse avant de la stocker dans le congélateur. Le soir même, le tonnerre gronda. Un orage force 7 éclata. En un rien de temps, ma cave fut complètement innondée… Nous ne nous sommes jamais régalés de cette viande, mais les acteurs de cette « corrida » se régalent encore, 41 ans plus tard, à l’évocation de cette anecdote…
Le veau dont je parle, nous a faussé compagnie exactement au même endroit où ce porc a été égorgé, en 1928, à la ferme de Truzugal.
Sur cette photo : Raphaël Nonen, marin d’Etat. Son épouse Maïvonne. Ce couple sans enfants vivait au bas de la Côte du Bourg, au niveau du moulin de Truzugal. Mme Adam, propriétaire de la ferme. Sa fille Augustine Adam qui deviendra l’épouse de François-Marie Goasampis. Ils ont vendu deux de leurs champs à la commune pour en faire le Camping. L’autre personnage (à droite), à coup sûr, le tueur de cochons, n’a pas été identifié.
JE ME SOUVIENS DE LOUIS LE CALVEZ qui éxerçait le dur métier du lin. Cet entretien avec Louis date de 1978…
J’ai commencé ce métier à l’âge de 14 ans. On disait « travailler au moulin » quand c’était à Milin Diriguin à Trélévern et ensuite « travailler au teillage » quand c’était chez Pierre Saliou à Kerscouac’h. D’abord, il fallait arracher le lin. La première fois que je l’ai fait, c’était en 1933 ou en 1934 à Park ar Bourg (ndlr : emplacement du stade municipal). Nous étions cinq.
Après, on étalait le lin sur un pré pour rouir pendant trois semaines à peu près. Ca dépendait du temps qu’il faisait. Au moulin, on passait le lin au « pilouar » pour le piler. On en faisait des poignées que l’on mettait sur la table. Certains d’entre nous passaient ces poignées dans des pales, on disait des spatules qui tournaient très vite et qui enlevait la chènevotte.
Il y avait un qui dégrossissait et un qui finissait. Avec la filasse, on faisait des paquets de 20 livres. Chacun pesait la part de son travail. Cette filasse était peignée avec la main dans une autre pièce. Avec ce qui tombait, on faisait de l’étoupe. Après, on faisait des ballots de 200 livres (100 kilos) en tassant l’étoupe dans un sac qui était pendu. De temps en temps, un camion de Lille venait chercher ces ballots.

Il y avait du travail toute l’année. Dans pratiquement chaque ferme, il y avait un tas de lin recouvert de paille. On nous demandait souvent de venir égrener le lin. La nourriture n’était pas toujours bonne dans les fermes.
C’était un travail dangereux. Jean Talbeau a eu son bras coupé au « pilouar ». Son bras est allé dedans. J’ai jeté la courroie à terre et sa main est sortie comme du pâté ! Avec les spatules, il ne fallait pas rigoler non plus.
Je peux te dire que là j’ai avalé de la poussière. Plus d’une brouettée et deux aussi ! J’ai commencé à chiquer à 14 ans pour cracher toutes ces saletés. On avalait la poussière 9 heures par jour. Je ne sais pas comment j’ai pu résister à cette saleté. Quand ça tournait, on ne voyait rien. Le travail était plus dur qu’à la ferme mais tu avais du travail à longueur d’année. Vider le trou sous le « brei », c’était le pire..
JE ME SOUVIENS DE JEAN TALBEAU, « Le Capitaine Crochet »…
J’ai connu Jean Talbeau (1903-1978) dans les années 50. C’était un collègue de mon père au teillage de lin de Pierre Saliou, à Kerscouac’h. Il m’impressionnait avec ce crochet en métal qui sortait de sa manche gauche. Plus tard, lorsque la culture du lin avait cessé en Trégor, je le croisais du côté de Nantouar lorsque nous allions « à la grève ». Je ne sais pas pourquoi nous ne disions pas « aller à la plage »…
Des documents fournis par la famille m’ont permis de reconstituer, peu ou prou, un suivi de la carrière de Jean…
1926 : Il part au Québec à bord du « Fleurus », ce qui est attesté par un document « Embarquement d’un marin français à bord d’un navire étranger »
1929 : Alors qu’il est incorporé au 2 ème Dépôt de Brest, le Docteur Even, député, sollicite pour Jean une dispense en qualité de soutien de famille.
1936 : Son nom apparaît comme employé d’une entreprise générale d’installation électrique (Service des chantiers extérieurs). C’est l’époque où les communes les plus en pointe se dotent d’un réseau électrique et où l’électricité rentre dans les maisons.
1940 : C’est la Deuxième Guerre Mondiale. On note la présence de Jean à Glasgow (Ecosse) à bord du « De Grasse »
1943 : Accident grave. Alors qu’il teille le lin, sa main gauche est écrasée dans le « pilouar ». Louis Le Calvez, témoin de la scène : « On aurait dit de la chair à pâté ! » Quelqu’un sectionne carrément à vif la petite partie qui tient. Appel est fait à Pierre Bourdellès, maire de la commune qui transporte le blessé à l’Hôpital de Lannion (actuellement locaux de l’ENSAT, près du Pont Saint-Anne)
Le Tribunal de Lannion alloue à Jean une rente annuelle viagère de 6 797,80 francs.
1944 : Un certificat de la Mairie de Louannec précise que Jean a travaillé pour le compte de la Défense passive au désamorçage de mines comme volontaire. Ses compétences sont reconnues : « Excellent démineur » relate un rapport du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme.
Dans un article de presse, le Sous-Lieutenant artificier Marceau Planne commente : « Sur les 7 militaires chargées du déminage à la Libération, il ne reste que 2 ! (ndlr : Les autres ont perdu la vie en déminant). Je démissionnerai lorsque je me verrai seul…Quant aux civils, plusieurs ont payé de leur vie leur dévouement. Vous pouvez rendre hommage au civil démineur Jean Talbot (orthographe qui apparaît dans plusieurs documents!) de Louannec. Bien qu’étant manchot du bras gauche, il a à son actif 15 000 mines ! »
1946 : Jean est affecté à l’équipe de déminage de Plouha. Il suit préalablement un cours de perfectionnement d’une semaine à l’Ecole Régionale de déminage de Saint-Brieuc.
1947 : Jean exerce son métier de démineur du côté de Belfort en Franche Comté et de Colmar en Alsace..
1949 : Jean qui travaillait à des travaux de terrassement à l’Entreprise « Erbetta » de Saint-Brieuc, doit quitter pour cause de la maladie. Un certificat de la Mairie de Louannec le déclare sans travail.
De 1949 à 1955 : Jean revient au teillage de lin de Louannec où il a perdu l’avant-bras gauche en 1943.
A partir de 1955, Jean qui est sans emploi se consacre à la pêche. Claudine, une de ses deux filles, explique : « Mon père a construit tout seul un bateau qu’il a appelé « Claudine ». J’avais une dizaine d’années. On allait à Tomé à la rame pêcher des ormeaux. »
1956 : Petit problème ! Il est reproché à Jean par l’Inscription Maritime de Lannion de « naviguer sans titre de navigation et d’avoir commis un délit de pêche ». La sanction sera adoucie parce que, j’aime bien cette expression, il n’est que « délinquant primaire » !
Raymonde Subil, son épouse, (1911-2011) a été longtemps la doyenne de la commune. Elle a travaillé en tant que laveuse chez Emile Campion, chez Nicolas à Keryann Bihan. Elle allait ramasser les pommes de terre chez « Titig » Trémel.
JE ME SOUVIENS D’ERNEST LE SAUX, fin pêcheur en rivière… J’ai recueilli ces propos en 1982.
« J’ai commencé à pêcher à l’âge de 7 ans. Comme je n’étais pas assez riche pour avoir une canne, je pêchais avec un bâton de noisetier, un fil et une aiguille recourbée. J’y mettais un ver. La première truite que j’ai prise devait peser une demi-livre ! Raymond Bricquir, qui est devenu boulanger, pêchait avec moi. Lui, il avait une canne et un moulinet. Moi, j’en avais fait un avec une bobine et deux pointes : une pour le fixer et l’autre pour tourner. Jusqu’à ce que Siméon est arrivé, il n’y avait pas de garde-pêche. Mon père craignait Siméon, pas moi !
Le bord de la rivière était beaucoup plus propre alors. Les prés étaient travaillés, l’herbe et le bois coupés. Chacun entretenait son bout de rivière. Maintenant, on demande aux gens d’aller nettoyer le Dourdu de Cabatous jusqu’à Nantouar.
J’ai pêché 8 truites récemment. Il y en a encore mais plutôt au-dessus de Cabatous. La meilleure pêche de ma vie, je l’ai faite entre Pont-Couennec et Kerprigent : 34 truites en une demi-journée ! Une autre fois, à Pont Albin, 6 dans l’après-midi, les plus belles, dans les deux livres chacune ! Je ne vendais pas ma pêche. On était une famille très nombreuse. Nous étions douze enfants et j’étais le plus âgé…
Les meilleurs pêcheurs de Louannec, étaient Quintric, le facteur, et moi. J’ai appris à pêcher à un pas mauvais non plus, Hervé Simon que j’emmenais avec moi sur le cadre de ma bicyclette.
J’ai aussi pêché en mer mais ça ne m’a jamais autant plu. J’ai été chercher des ormeaux, des congres et aussi des homards. Je connaissais des trous où tu étais sûr d’en trouver un jour ou l’autre. »
JE ME SOUVIENS DE JULES MILIN NOZ et de sa triste fin…
Il se prénommait Jules. On l’appelait Jules Milin Noz, du nom de son moulin. Ce n’était pas la belle bâtisse restaurée que l’on voit aujourd’hui. Notre Maître Cornille vivait dans une masure en ruines, au toit éventré. Depuis bien longtemps, personne n’y apportait du blé à moudre…
Autrefois, cette partie terminale de la vallée du Dourdu était animée. Il y avait un chapelet de quatre moulins : celui de Cabatous, celui de Milin Dirigin, celui de Keryann et enfin le moulin de Jules. Ou ce qu’il en restait…
Jules régnait en maître sur ce territoire isolé. Presque en ermite. A l’époque, la mode n’était pas à la randonnée et rares étaient les passants qui pouvaient l’importuner. Jules recevait. Des amis qui comme lui tiraient le diable par la queue. Le bonheur, ils le trouvaient au fond des bouteilles de Santa Rosa et de Grappilru… C’était leur unique moyen de chasser leurs idées noires. Pour voir la vie en rose…
Quand l’Ankou commença à rôder près de chez Jules, ses amis commencèrent à s’inquiéter. Un soir, Jules fut pris de convulsions. C’était des râles signes précurseurs de la dernière heure. Ils étaient venus ; ils étaient tous là, il va mourir, etc… L’un d’eux alla prévenir le médecin de Trélévern… Le Docteur Droumaguet venait de s’installer dans le village et c’était une de ses premières interventions sur le terrain . Une fois sur place, le praticien fut surpris et sidéré par l’état des lieux et par le manque d’hygiène : amas de bouteilles vides, assiettes ébréchées et sales. Un véritable taudis Le patient était couché presqu’à même une planche en chêne, gémissant. Les amis de Jules qui étaient restés à son chevet. Ces apprentis-sorciers, avinés, pensaient avoir trouver la recette qui remettrait leur ami sur pied. Ils essayaient de lui faire avaler un œuf cru avec un verre de cidre. Mais Jules rendit l’âme avant d’accepter cette thérapie de choc…
Deux jours plus tard, Jules fut conduit à l’église et au cimetière de Trélévern. A sa dernière demeure, selon l’expression consacrée. L’ami qui portait la croix marchait de guingois : un coup à gauche, un coup à droite. Pour lui, la ligne droite n’était pas le plus court chemin…
Misère, misère, chantait Coluche. Une misère engendrait des scènes aussi cocasses et rocambolesques dans nos campagnes, en ce temps-là…
PS : Tous les acteurs de cette sinistre soirée, je les connaissais bien. Ils n’avaient pas eu la chance d’être nés sous une bonne étoile. Ils étaient rustres, paumés. Mais c’était des gens comme on en rencontrait dans nos campagnes. Des gens capables de rendre service.
IL Y A 50 ANS, LA RELIGION ÉTAIT TRÈS PRÉGNANTE…
Sur certaines maisons anciennes de Louannec, on peut voir en façade une niche destinée à une statue de la Vierge. Là ne s’arrêtaient pas les signes qui marquaient la présence de la religion. Tout d’abord, avant d’installer la famille dans la maison, on faisait appel au Recteur de la paroisse pour bénir les lieux. L’homme d’église aspergeait les pièces d’eau bénite en chantant des psaumes. Dans chaque pièce était installé un crucifix avec quelquefois à la base un petit bénitier. Sous ce crucifix était souvent glissé un rameau de buis qui avait été bénit le dimanche précédant Pâques.
Tous les dimanches, il y avait deux offices qui faisaient le plein : messe du matin à 9h et grand-messe à 10h30. Conviction religieuse pour certains, pour faire comme les autres pour d’autres ou pour boire un canon avec les copains et s’informer des nouvelles des autres quartiers, de l’état des récoltes et du bétail…
A l’occasion de la Saint-Yves, il y avait une procession jusqu’à Poulajou où avait lieu un feu de joie.
Je me souviens qu’à Mabiliès, une fois l’an, en semaine, pour le jour des Rogations, on décorait la croix-calvaire. Le lendemain matin, le Recteur accompagné d’un enfant de choeur, faisait halte alors qu’il se renadit à pied à la chapelle de Kerallain. Dans ses prières, l’Abbé demandait la pluie si c’était période sécheresse et le soleil si c’était trop humide…
Nous, les enfants, devions suivre deux séances de catéchisme par semaine : le samedi et le dimanche jusqu’à la Communion solennelle. Ce jour donnait lieu à une fête de famille de grande ampleur : achat d’un costume, achat d’un missel ou livre de messe, d’images de communion mises au nom du communiant par un imprimeur, méga-repas. Ce dimanche était précédé par une retraite où intervenaient des prêtres extérieurs à la paroisse.
L’Evêque de Saint-Brieuc venait tous les quatre ans pour présider à la Confirmation que les jeunes de Louannec faisaient en même temps que ceux de Saint-Quay-Perros.